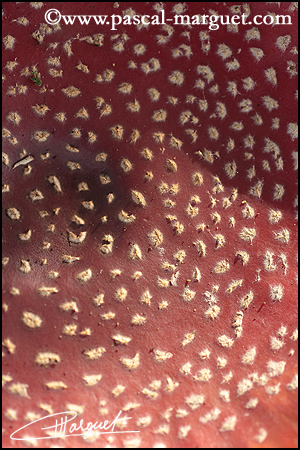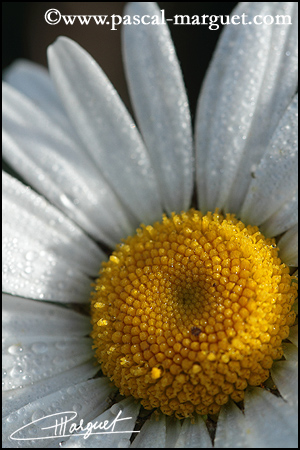Suggestion de lecture :
" 1
DERNIÈRES VISIONS DU PORT
D’un coup, la ville devint folle. Lorsque les
dirigeants de GoldTex annoncèrent que le rachat de la Grèce
était finalisé, les citoyens d’Athènes furent pris de
panique. Eux qui s’étaient massivement opposés à cette
acquisition, qui, durant des mois, avaient manifesté,
soutenu la jeunesse lorsqu’elle construisait des barricades
et jurait d’aller jusqu’au bout, finirent par se tourner
vers l’oppresseur et voulurent tous partir. Même les plus
réticents étaient en proie à cette obsession : quitter la
ville, ne pas rester prisonniers de ce piège, rejoindre au
plus vite GoldTex et poursuivre leur vie ailleurs. Ils
sentaient bien que leur monde allait disparaître et ils
avaient peur. Des rumeurs circulaient : on disait qu’il
fallait faire vite, que seuls les premiers seraient pris,
que le sort des autres promettait d’être sombre. On disait
que la Grèce allait être démembrée, vendue par morceaux, et
que ceux qui resteraient habiteraient bientôt sur une terre
d’esclaves, oubliés de tous.
Il
fallait
s’en aller. Plus personne n’en doutait. La folie
s’emparait de la rue. Sur l’avenue Tsaldari, une femme
qui traînait derrière elle deux valises et ses trois
enfants en bas âge s’arrêta net, se dégrafa jusqu’à
montrer sa poitrine et se mit à hurler :
« Prenez-nous ! Prenez-nous puisque vous achetez
tout ! » Sur
le
boulevard Thiseos, des hommes essayèrent de forcer un
taxi à rejoindre le port. Devant la résistance du
chauffeur qui s’enferma dans l’habitacle, ils finirent
par saccager le véhicule, puis l’asperger d’essence et
danser autour avec une rage qu’eux-mêmes, des jours
plus tard, furent incapables d’expliquer. La défaite
était consommée et la ville entière voulait fuir. Mais
cela ne dura que quelques jours. Très vite, une
résignation silencieuse succéda aux comportements les
plus fous. Si c’était encore de la panique, elle était
d’une autre nature. Les gens sortaient dans la rue
avec accablement, comme s’ils s’étaient résolus à
n’être que du bétail, comprenant que leur
individualité ne pouvait plus s’opposer à rien de ce
qui venait. Athènes marchait tête basse. Les familles
avançaient, visage fermé, sans un mot. Toutes les
artères qui menaient au port, à la gare ou à
l’aéroport étaient saturées. Dans un réflexe absurde,
beaucoup prenaient leur voiture, puis, une fois
bloqués dans des embouteillages démesurés, constatant
qu’ils ne pourraient plus ni avancer ni faire
demi-tour, abandonnaient leur véhicule en plein milieu
de la route pour poursuivre à pied, rajoutant ainsi
encore au chaos. La longue file de voitures
abandonnées semblait désormais n’être là que pour
obliger les foules à des circonvolutions cruelles :
rentrer le ventre, mettre sa valise sur la tête, se
faufiler entre les carrosseries qui brillaient au
soleil et réverbéraient une chaleur insupportable. Sur
la bretelle périphérique qui menait à l’aéroport, le
spectacle était inouï : des hommes et des femmes, par
milliers, patients, résignés.
Malgré les annonces qui précisaient régulièrement que plus
aucun avion ne prenait de passager, que de toute façon il
était impossible d’atteindre les aérogares tant il y avait
de gens sur place, la foule continuait à se présenter dans
le vain espoir qu’un pilote finisse par contrevenir à tous
ces ordres. La ville entière voulait partir mais elle était
immobilisée par son propre nombre. Les rues grondaient du
piétinement des foules impatientes, de ces milliers
d’enfants tenus par la main à qui on disait de cesser de
pleurer. Lorsque les nouveaux arrivants découvraient cette
marée humaine, étrangement, au lieu de rebrousser chemin,
ils y prenaient place avec l’assurance que c’était bien là
qu’il fallait être, faisant taire en eux leur bon sens, et
même leur instinct de survie, acceptant de s’annihiler dans
la masse comme s’il y avait un réconfort à se presser ainsi
les uns contre les autres, celui, peut-être, de constater
qu’ils n’étaient pas seuls et que leur frayeur et leur
infortune étaient partagées. Tout était lent et pénible. La
foule était exaspérée par sa propre impuissance. Il fallait
supporter cette attente qui, au mieux, n’amènerait qu’au
triste contentement d’avoir gagné quelques dizaines de
mètres et au pire, vous excitait les nerfs.
Lui, comme les autres, s’était levé pour partir
mais, à la différence de toutes ces familles apeurées, il
avait un badge et un brassard qui lui permettaient de passer
les barrages, de doubler les files immobiles. On l’enviait
pour cela. Il le sentait dans le regard que les femmes
épuisées lui lançaient.
Sur le port du Pirée, deux paquebots s’apprêtaient
à quitter Athènes. C’étaient des bêtes immenses mais qui
semblaient bien petites au vu de ces milliers de candidats
qui espéraient monter à bord. L’embarquement avait commencé.
Tous avançaient vers la passerelle avec une lenteur inventée
par un bourreau méthodique. Il fallait montrer ses papiers,
renoncer aux objets trop volumineux qu’on avait espéré
pouvoir emporter. C’était chaque fois des cris, des
protestations, des tentatives vaines de convaincre.
Il regardait cette humanité défaite et se sentait
honteux de la quitter. Le navire militaire qui était à quai,
plus petit que les deux autres, semblait l’attendre.
Personne ne s’en approchait. Il était protégé par des
soldats qui tenaient à distance les candidats à l’exil.
C’est là qu’il allait d’un pas rapide. Deux jours plus tôt,
il avait reçu son ordre d’évacuation personnel. Il avait
fallu essayer de faire tenir dans sa petite valise tous les
objets de son quotidien. Il n’avait dit au revoir à
personne. Ses parents étaient morts quelques années plus
tôt, et pour la première fois, il en fut heureux car il
pensa à la tristesse qui les aurait saisis s’il leur avait
été donné de voir ce naufrage. Le bateau finissait de faire
le plein. Il monta à bord et s’installa sur le pont pour
observer le plus longtemps possible ce pays qu’il quittait.
Cela aurait dû durer des heures encore, le temps
que l’équipage termine les dernières vérifications, mais
soudain, un bruit fracassant déchira ses oreilles. Il sentit
un souffle chaud sur son visage et dut s’accrocher à la
rambarde pour ne pas tomber à terre. Une explosion venait de
souffler, en une fraction de seconde, toutes ces vies,
toutes ces valises, ces familles encombrées. Elle avait même
percé la coque du paquebot d’à côté. De là où il était, il
vit la foule refluer vers les hangars. C’était la panique.
Plus rien n’existait de la calme lenteur qui régnait encore
l’instant d’avant. Des corps tombaient, d’autres les
piétinaient sans même s’en rendre compte. Des mains
lâchaient des enfants. Des familles se retrouvaient
séparées. Et puis, quelques minutes plus tard, du côté des
hangars, à l’endroit où tout le monde accourait pour
s’éloigner le plus possible du lieu frappé par la mort, une
seconde bombe explosa, tuant ceux qui croyaient s’être
sauvés. C’était imparable et monstrueux. Tout saignait. Tout
gémissait. Plus personne ne savait vers où fuir. Lui était
tétanisé. Il ne pouvait plus quitter des yeux ce spectacle
horrible. Il savait qu’il faudrait des heures pour retrouver
les victimes et les compter. Des heures pour évacuer la zone
et organiser le secours des blessés. Des heures pour
ramasser les corps en miettes. Il était abasourdi,
impuissant devant le carnage, avec, sous les yeux, cette
foule indistincte qui venait de perdre tout espoir. Il pensa
immédiatement au groupuscule Tigimas*. C’était probablement
lui qui venait de frapper. Cela faisait des semaines qu’il
menaçait de s’en prendre aux civils. Il avait prévenu qu’il
ciblerait les gares et les ports pour empêcher les départs.
Tout allait devenir laid. La Grèce allait être brûlée,
écrasée. Elle allait se dévorer elle-même. Il était là, lui,
accablé par ce spectacle d’horreur, inutile, parce que loin,
déjà si loin, séparé du drame par les bastingages, par la
hauteur du bâtiment et par le fait que le capitaine avait
ordonné de précipiter le départ et de larguer les amarres au
plus vite. La lenteur avec laquelle le navire quitta le port
contrastait avec la fureur qui régnait sur les quais. Il
resta sur le pont, ne pouvant quitter des yeux, face à lui,
la ville qui fumait, souffrait, criait. Les familles,
là-bas, comprenaient que les bateaux ne partiraient pas
aujourd’hui, qu’elles étaient prises au piège, frappées de
tous côtés. Il les regarda pendant de longues minutes. Il ne
pouvait plus rien, n’était déjà plus l’un d’eux. Il savait
qu’il ne reviendrait plus. C’était la dernière image
d’Athènes qu’il emportait avec lui : une ville à la
bouche grande ouverte qui sentait la poudre et le sang. Tout
était fini. Il ne serait plus jamais grec..."
* « τη γη μας (ti gi mas) » : « Notre terre », en
grec.