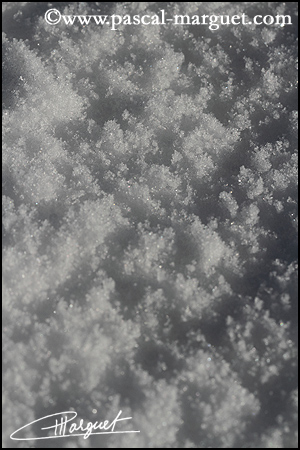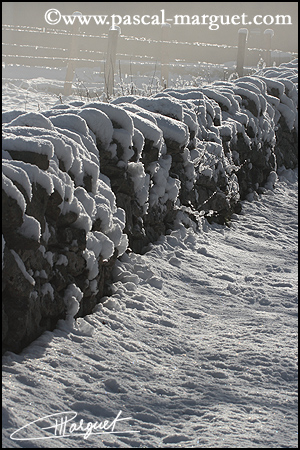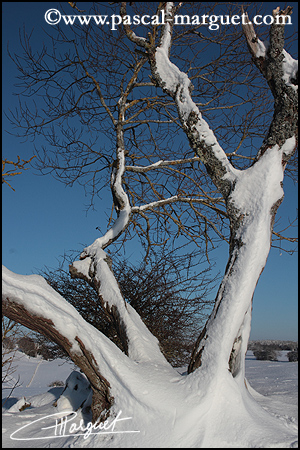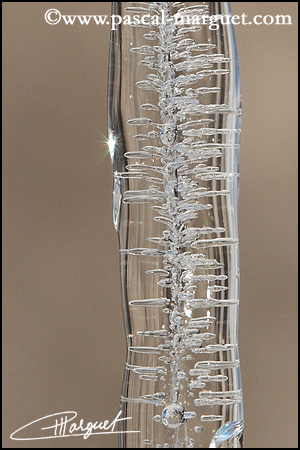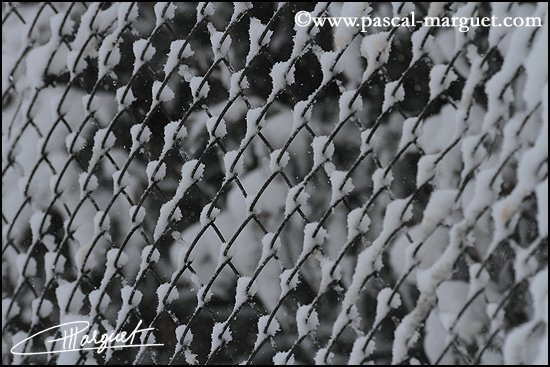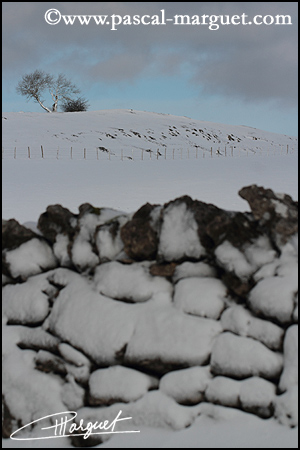Chronique de France-Inter, du jeudi 11 février
dernier :
cliquez
sur le lien ci-dessous :
Suggestion
de lecture :
"
11
Les bambous, les cigales et
l’économie selon Adam Smith
La nature parvient
généralement à faire mieux que les légendes humaines les
plus invraisemblables. La Belle au bois dormant a attendu
son prince pendant cent ans. Selon Bettelheim, la piqûre au
doigt symbolise l’apparition de la première menstruation et
le sommeil, la léthargie de l’adolescence, qui précède
l’éveil de la maturité. Puisque la Belle au bois dormant a
été fécondée par un roi et non simplement embrassé par un
prince, on peut dire que son réveil a marqué le début de sa
maturité sexuelle. Un bambou, qui porte le nom extravagant
de Phyllostachys bambusoïdes, a fleuri en Chine en
l’an 999. Depuis, avec une régularité qui ne s’est jamais
démentie, il a continué de fleurir et de libérer des graines
une fois tous les cent vingt ans environ. P. bambusoïdes
se conforme à ce cycle quel que soit l’endroit où il se
trouve. Vers la fin des années soixante, une population
japonaise (importée elle-même de Chine des siècles
auparavant) a fleuri simultanément au Japon, en Angleterre,
en Alabama et en Russie. La comparaison avec la Belle au
bois dormant n’est pas tirée par les cheveux, car la
reproduction sexuelle intervient, chez ces bambous, après
plus d’un siècle de célibat. Mais P. bambusoïdes
s’éloigne des frères Grimm sur deux points importants. D’une
part, les plantes ne sont pas inactives pendant leur sommeil
de cent vingt ans, car ce sont des herbes, et elles se
propagent en produisant de nouvelles pousses à partir de
rhizomes souterrains. D’autre part, elles ne vivent pas
heureuses et n’ont pas beaucoup d’enfants, car elles meurent
après avoir libéré leurs graines…
L’écologiste Daniel H.
Janzen, de l’université de Pennsylvanie, raconte l’histoire
étrange du Phyllostachys dans un article récent : « Pourquoi
les bambous fleurissent si rarement ». Chez la plupart des
espèces, la période de croissance végétative séparant deux
floraisons est plus courte, mais la synchronisation de la
libération des graines est la règle, et rares sont les
espèces qui laissent passer moins de quinze ans entre deux
floraisons. La floraison d’une espèce est réglée par une
horloge intérieure et ne lui est jamais imposée de
l’extérieur par l’environnement. La régularité infaillible
des intervalles en est la meilleure preuve car, à notre
connaissance, aucun facteur environnemental ne possède un
cycle assez régulier pour produire les divers rythmes de
floraison de plus d’une centaine d’espèces. De plus, les
plantes appartenant à une même espèce fleurissent
simultanément, même lorsqu’elles se trouvent dans des
environnements très différents. Janzen cite le cas d’un
bambou birman qui ne mesurait qu’une trentaine de
centimètres de haut parce qu’il avait été plusieurs fois
détruit par des incendies de forêt, mais qui a fleuri en
même temps que ses congénères, hauts de 12 mètres, qui
n’avaient pas été touchés. Comment le bambou fait-il pour
compter les années ? Selon Janzen, il ne mesure pas les
quantités de nourriture accumulées, puisque les spécimens
nains, à demi morts de faim, fleurissent en même temps que
les géants débordants de santé. Il suppose que le calendrier
« doit être fonction de l’accumulation ou de la dégradation
d’un produit chimique sensible à la lumière et non à la
température ». Rien ne lui permet de dire si le cycle est
diurne (jour-nuit) ou annuel (saisonnier). À l’appui de son
hypothèse, Janzen fait remarquer qu’aucun bambou à cycle
correct ne pousse à l’intérieur d’une bande délimitée par
les parallèles 5°N et 5°S, car autour de l’équateur les
variations dans les jours et les saisons sont très faibles.
Le mode de floraison du bambou évoque un autre phénomène
périodique plus connu : celui des cigales « périodiques ».
Le mode de vie de ces cigales est encore plus extraordinaire
qu’on ne le croit généralement. Dans toute la moitié
orientale des États-Unis (sauf dans les États du Sud, où un
groupe d’espèces similaires émerge tous les treize ans), la
nymphe vit sous terre pendant dix-sept ans, se nourrissant
de la sève contenue dans les racines des arbres. Puis, en
quelques semaines, des millions de nymphes parvenues à
maturité sortent de terre, deviennent adultes, s’accouplent,
pondent et meurent. Le plus remarquable est que non pas une,
mais trois espèces différentes de cigales suivent
précisément le même rythme et sortent de terre exactement en
même temps. Il arrive que certaines populations soient
déphasées. Les nymphes ne sortent pas de terre en même temps
dans la région de Chicago et en Nouvelle-Angleterre. Mais le
cycle de dix-sept ans (treize ans dans le Sud) est commun à
toutes les « portées », et les trois espèces sortent
toujours en même temps dans un endroit donné. Janzen admet
que les cigales et les bambous, malgré la distance qui les
sépare, biologiquement et géographiquement, posent le même
problème d’évolution. Les recherches actuelles, écrit-il, «
ne mettent en évidence aucune différence qualitative entre
ces insectes et les bambous, sauf, peut-être, en ce qui
concerne la méthode utilisée pour comptabiliser les années
». Pourquoi cette synchronisation, et pourquoi un si long
intervalle entre deux périodes de reproduction sexuelle ?
Comme je l’ai dit en rapportant les habitudes matricides de
certaines mouches, la validité de la théorie de la sélection
naturelle n’est jamais mieux démontrée que lorsqu’elle
permet d’expliquer d’une manière satisfaisante ce qui, de
prime abord, nous paraît étrange et dénué de sens. Dans ce
cas, nous sommes confrontés à un problème qui dépasse
l’excentricité apparente d’un tel gaspillage (car très peu
de graines peuvent germer sur un sol aussi saturé). Il
semble que la floraison et la sortie de terre procèdent d’un
programme concernant l’espèce dans son ensemble, et non plus
les individus qui la composent. Pourtant, la théorie
darwinienne repose sur l’idée que chaque individu ne sert
que son intérêt personnel, c’est-à-dire la transmission de
ses gènes aux générations suivantes. Nous devons nous
demander quel avantage une cigale ou un bambou tirent de la
synchronisation de la reproduction sexuelle. C’est un peu le
même problème que celui qu’eut à résoudre Adam Smith quand
il se prononça pour la politique du laisser-faire, la
considérant comme le meilleur moyen de promouvoir une
économie harmonieuse. L’économie idéale, d’après Smith, bien
que structurée et équilibrée, apparaîtrait « naturellement »
comme une conséquence directe de l’interaction des
individus, qui ne cherchent qu’à agir au mieux de leurs
intérêts particuliers. Ce qui paraît être la volonté
d’accéder à une harmonie plus élaborée n’est, selon la
métaphore célèbre d’Adam Smith, que l’action d’une « main
invisible ». « Comme l’individu […] en organisant son
activité de telle sorte que ce qu’il produit a davantage de
valeur, ne recherche que son intérêt personnel, il est, dans
tous les cas, poussé, par une main invisible, à atteindre
des objectifs qui n’entraient pas dans ses intentions… Il
lui arrive souvent, en recherchant son intérêt personnel, de
servir celui de la société plus efficacement que lorsqu’il
cherche effectivement à la servir. » Puisque Darwin a
appliqué à la nature l’idée d’Adam Smith, il nous faut
chercher l’explication de l’harmonie dans les avantages
qu’elle confère aux individus. Donc, que gagnent une cigale
ou un bambou donnés à ne s’adonner au sexe que si rarement,
et en même temps que leurs congénères ? La biologie humaine
donne souvent une idée fausse des difficultés que doivent
surmonter les autres organismes. Les êtres humains sont des
animaux à développement lent. Ils investissent de grandes
quantités d’énergie dans la conception d’un très petit
nombre de descendants, qui ne deviennent adultes que très
tard. Nos populations ne sont pas tributaires de la mort
massive de presque tous leurs jeunes. Mais il ne faut jamais
oublier que beaucoup d’organismes emploient une stratégie
différente dans la « lutte pour la vie » : ils produisent
des quantités énormes de graines et d’œufs en espérant –
pour ainsi dire – que quelques-uns survivront aux rigueurs
des premiers jours. Ces organismes sont sous la coupe de
leurs prédateurs et, pour se défendre, ils doivent élaborer
une stratégie réduisant au minimum le risque d’être dévoré.
Or beaucoup d’animaux semblent particulièrement friands de
cigales et de graines de bambou. Les sciences naturelles,
dans une large mesure, ont mis en évidence les différents
types d’adaptation qui permettent de déjouer les prédateurs.
Certains animaux se dissimulent, d’autres sentent mauvais,
d’autres encore ont des piquants ou d’épaisses carapaces ;
la liste est pratiquement interminable, et il faut en rendre
hommage à la variété de la nature. Les graines de bambou et
les cigales emploient une stratégie peu commune : elles sont
absolument offertes sans défense, mais si rarement et en si
grande quantité que les prédateurs sont dans l’incapacité de
tout consommer. Les biologistes de l’évolution appellent
cette méthode de défense la « saturation du prédateur ».
Pour être efficace, cette stratégie doit reposer sur deux
adaptations. Premièrement, la synchronisation de la
production doit être parfaite – de telle sorte que le marché
soit réellement saturé – et ne pas durer longtemps.
Deuxièmement, il faut que cette situation ne se produise que
rarement, de peur que les prédateurs n’adaptent leur cycle
de vie aux périodes d’abondance. Si les bambous
fleurissaient tous les ans, les animaux qui se nourrissent
des graines découvriraient l’existence du cycle et
offriraient la récolte annuelle à leur abondante
progéniture. Mais si l’intervalle entre deux floraisons
dépasse nettement l’espérance de vie de tous les prédateurs,
il est impossible à ceux-ci de découvrir l’existence du
cycle. L’avantage que les bambous et les cigales,
individuellement, tirent de la synchronisation apparaît
clairement : tous ceux qui ne suivant pas le rythme sont
rapidement dévorés (des cigales sortent parfois de terre
pendant les années creuses, mais elles ne peuvent se
maintenir). L’hypothèse de la « saturation du prédateur »,
bien qu’elle n’ait pas été testée, comporte l’élément
fondamental d’une analyse correcte. Elle permet de rendre
compte d’une suite d’observations qui, sans elle,
resteraient indépendantes les unes des autres, donc,
totalement inexplicables. Nous savons, par exemple, que les
graines de bambou sont très prisées par divers animaux, y
compris des vertébrés, qui vivent longtemps, d’où la rareté
des cycles inférieurs à quinze ou vingt ans. Nous savons
également que la libération simultanée des graines peut
littéralement inonder la région concernée. Janzen parle d’un
matelas de 20 centimètres d’épaisseur sous la plante
parentale. Deux espèces de bambous malgaches déversent 50
kilos de graines à l’hectare, sur une surface totale de 100
000 hectares, pendant la floraison. La synchronisation de
trois espèces, chez les cigales, est particulièrement
impressionnante, en particulier parce que l’année où elles
sortent de terre varie d’un endroit à l’autre, alors que les
trois espèces font surface en même temps dans un endroit
donné. Mais le plus étonnant est fourni par les cigales
elles-mêmes. Pourquoi y a-t-il des cigales à 13 ans et des
cigales à 17 ans, mais aucune cigale à 12, 14, 15, 16 ou 18
ans ? Treize et dix-sept ont un point commun. Ce sont des
nombres assez élevés pour dépasser l’espérance de vie de
tous les prédateurs, mais ce sont également des nombres
premiers (qui ne sont divisibles par aucun nombre plus petit
qu’eux-mêmes). La plupart des prédateurs éventuels ont un
cycle de deux à cinq ans. Leurs cycles ne sont pas fonction
de l’apparition des cigales périodiques (car leurs
populations atteignent souvent un maximum dans les années où
il n’y a pas de cigales). Cela n’empêche qu’ils dévorent les
cigales avec voracité lorsque les cycles coïncident. Prenons
un prédateur avec un cycle de cinq ans. En employant un
grand nombre premier, les cigales réduisent le nombre des
coïncidences (une fois tous les 5 × 17, soit 85 ans, dans ce
cas). Un cycle de treize ou dix-sept ans ne peut être percé
à jour par un cycle plus court. L’existence, comme l’a dit
Darwin, est une lutte pour la plupart des êtres vivants. Les
armes de la survie ne sont pas forcément les griffes et les
dents ; le mode de reproduction est parfois tout aussi
efficace. Et la surabondance est l’un de ces moyens. Il est
parfois sage de mettre tous ses œufs dans le même panier…
mais il faut en avoir beaucoup, et ne pas s’y risquer trop
souvent..."