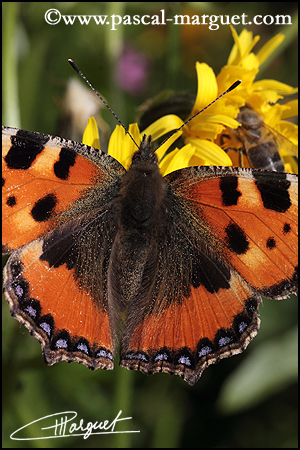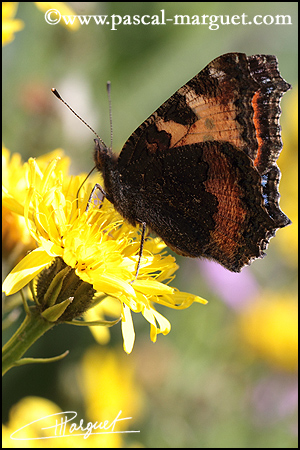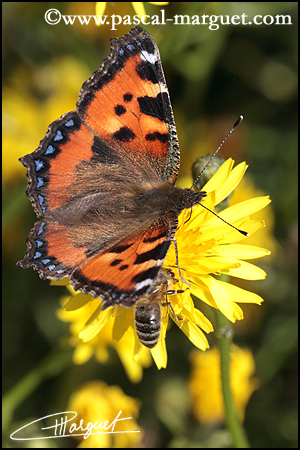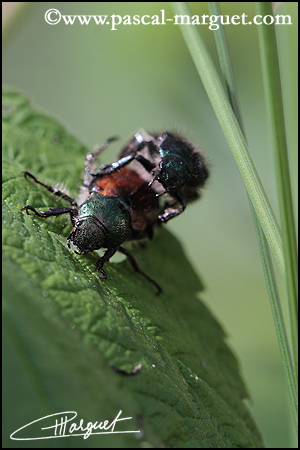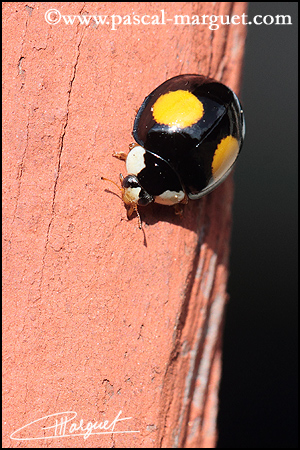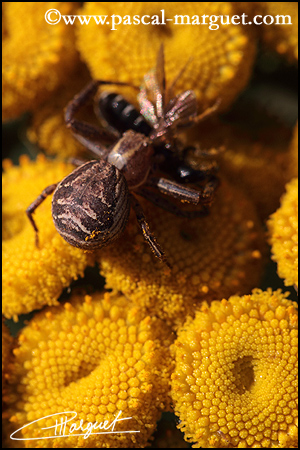Suggestion de
lecture :
"
XIX
SOUVENIRS D’ENFANCE
Presque à l’égal
de l’insecte, joie de l’enfant, qui se complaît à
élever Hannetons et Cétoines sur un lit d’aubépine
fleurie, dans une boîte percée de trous ; presque
à l’égal de l’oiseau, irrésistible tentation avec
ses nids, ses œufs, ses petits ouvrant leur bec
jaune, le champignon m’a de bonne heure séduit par
ses colorations si variées. Naïf garçonnet
étrennant ses premières bretelles, et commençant à
se retrouver dans le grimoire de la lecture, je me
revois en extase devant le premier nid trouvé et
le premier champignon cueilli. Racontons ces
graves événements. La vieillesse aime à ruminer le
passé.
Temps
bienheureux où la curiosité s’éveille et nous
dégage des limbes de l’inconscience, votre
lointain souvenir me fait revivre mes plus belles
années. Surprise par un passant dans sa sieste au
soleil, la jeune couvée de la perdrix
précipitamment se disperse. Chacun, gracieuse
boule de duvet, s’enfuit et disparaît dans les
broussailles ; mais la tranquillité revenue,
à la première note d’appel, tous reviennent sous
l’aile maternelle.
Ainsi
reviennent, rappelés par l’évocation, mes
souvenirs d’enfance, autres oisillons tant
déplumés par les ronces de la vie. Divers,
échappés des buissons, ont la tête endolorie, le
pas chancelant ; divers manquent, étouffés
dans quelque recoin des halliers ; divers
sont conservés dans leur pleine fraîcheur. Or de
ces échappés à la griffe du temps, les plus
vivaces sont les premiers nés. La molle cire de la
mémoire enfantine s’est convertie pour eux en
bronze inaltérable.
Ce jour-là,
riche d’une pomme pour mon goûter et libre de mon
temps, je me proposais de voir la crête de la
colline voisine, jusqu’ici pour moi confins du
monde. Il y a tout là-haut une rangée d’arbres
qui, tournant le dos au vent, s’inclinent et
s’agitent comme pour se déraciner et fuir. De la
petite fenêtre de ma maison, que de fois ne les
ai-je pas vus saluant de la tête en temps
d’orage ; que de fois ne les ai-je pas
regardés se tourmentant en désespérés au milieu de
la fumée des neiges que le coup de balai de la
bise soulève et lisse, sur les pentes ! Que
font-ils là-haut, ces arbres désolés ?
Je m’intéresse à
leur souple échine, aujourd’hui tranquille dans le
bleu du ciel, demain secouée quand passent les
nuages. Je me réjouis de leur calme, je m’afflige
de leurs gestes effarouchés. Ce sont des amis. À
toute heure, je les ai sous les yeux. Le matin,
derrière leur clair rideau, le soleil se lève et
monte dans sa gloire. D’où vient-il ? Montons
là-haut, et peut-être l’apprendrai-je.
Je gravis la
pente. C’est une maigre pelouse tondue des
moutons. Pas un buisson, fertile en déchirures
dont j’aurais la responsabilité en rentrant à la
maison ; pas de rochers non plus, d’escalade
compromettante. Rien autre que de larges pierres
plates, çà et là clairsemées. Il n’y a qu’à
cheminer tout droit, en terrain uni. Mais la
pelouse a l’inclinaison d’un toit. Elle est
longue, longue, et mes jambes sont bien courtes.
De temps en temps je regarde là-haut. Mes amis,
les arbres de la cime, ne semblent pas se
rapprocher. Hardi, petit ! grimpe toujours.
Que vois-je là,
à mes pieds ? Un bel oiseau vient de
s’envoler de sa cachette sous l’auvent d’une large
pierre. Bénédiction du Ciel, il y a un nid de
crins et de fines pailles. C’est le premier que je
trouve, la première des joies que me vaudra
l’oiseau. Et dans ce nid, il y a six œufs,
joliment groupés à côté l’un de l’autre ; et
ces œufs sont d’un bleu magnifique, comme trempés
dans une teinture de céleste azur. Terrassé de
bonheur, je m’étends sur la pelouse et contemple.
Cependant la
mère, avec un petit claquement de gosier, tack,
tack, vole inquiète d’une pierre à l’autre,
non loin de l’indiscret. Mon âge est sans pitié,
trop barbare encore pour comprendre les angoisses
maternelles. Un projet me roule dans la tête,
projet de petite bête de proie. Je reviendrai dans
quinze jours cueillir la nichée avant qu’elle
parte. En attendant, prenons un de ces jolis œufs
bleus, un seul, témoignage triomphal de ma
découverte. Crainte d’écrasement, la fragile pièce
est déposée sur un peu de mousse dans le creux de
la main. Qu’il me jette la pierre celui qui, dans
son enfance, n’a pas connu l’ivresse du premier
nid trouvé.
Ma délicate
charge, que mettrait à mal un faux pas, me fait
renoncer au reste de l’ascension. Un autre jour je
verrai les arbres de la crête où se lève le
soleil. Je redescends la pente. Au bas je
rencontre M. le vicaire, qui faisait sa
promenade en lisant son bréviaire. Il me voit
cheminer gravement ainsi qu’un porteur de
reliques ; il aperçoit ma main qui dissimule
quelque chose derrière le dos.
« Qu’as-tu
là, petit ? » demande l’abbé.
Tout confus,
j’ouvre la main et montre mon œuf bleu sur un lit
de mousse.
« Ah !
un œuf de Saxicole, fait le vicaire. Où donc as-tu
pris cela ?
– Là-haut, sous une pierre. »
De question en
question, ma peccadille est confessée. Le hasard
m’a fait trouver un nid alors que je n’en
cherchais pas. Il y avait six œufs. J’en ai pris
un, que voilà, et j’attends l’éclosion des autres.
Je reviendrai lever la nichée lorsque les jeunes
auront aux ailes les canons des grosses plumes.
« Mon petit
ami, répond l’abbé, tu ne feras pas cela. Tu ne
déroberas pas à la mère sa couvée ; tu
respecteras l’innocente famille ; tu
laisseras grandir et s’envoler du nid les oiseaux
du bon Dieu. Ils sont la joie des champs, ils
expurgent la terre de sa vermine. Si tu veux être
sage, tu ne toucheras plus au nid. »
Je le promets,
et l’abbé continue sa promenade. Je revins à la
maison avec deux bonnes semences jetées dans les
friches de mon intellect d’enfant. Une parole
autorisée venait de m’apprendre que gâter des nids
est une action mauvaise. Je n’avais pas bien
compris comment l’oiseau nous vient en aide en
détruisant la vermine, fléau des récoltes ;
mais, tout au fond de mon cœur, j’avais senti que
c’est mal d’affliger les mères.
Saxicole, avait
prononcé l’abbé en voyant ma trouvaille.
Tiens ! me disais-je, tout comme nous les
bêtes ont des noms. Qui les a dénommées ?
Comment s’appellent telle et telle autre de mes
connaissances dans les prairies et les bois ?
Que veut dire le motsaxicole ?
Des années
passent, et le latin m’apprend que saxicole
signifie habitant des rochers. Mon oiseau, en
effet, tandis que j’étais en extase devant ses
œufs, volait d’une pointe de rocher à
l’autre ; sa maison, son nid, avait pour
toiture le rebord d’une large pierre. Un progrès
de plus glané dans les livres m’apprit que l’ami
des coteaux pierreux se nommait aussi Motteux,
parce que, en saison de labour, il vole d’une
motte à l’autre, inspectant les sillons riches de
vermisseaux déterrés. Sur la fin, je connus
l’expression provençale de Cul-blanc, expression
bien imagée elle aussi, rappelant la tache du
croupion qui s’étale en papillon blanc lorsque,
d’un bref essor, l’insecte voltige dans les
guérets.
Ainsi naissait
le vocabulaire qui devait un jour me permettre de
saluer de leur vrai nom les mille acteurs de la
scène des champs, les mille fleurettes nous
souriant au bord des sentiers. Le terme que le
vicaire avait prononcé, sans y ajouter la moindre
importance, me révélait un monde, celui des herbes
et des bêtes désignées par leur vrai nom. Laissons
à l’avenir le soin de débrouiller un peu l’immense
lexique ; pour aujourd’hui souvenons-nous du
Saxicole.
Au couchant, mon
village croule en cascade de jardinets où
mûrissent la prune et la pomme. De petits murs
ventrus, noircis par la lèpre des lichens et des
mousses, soutiennent les terres étagées. Au bas de
la pente est le ruisseau. Presque partout, d’un
élan on peut le franchir. Aux endroits étalés en
nappe, des pierres plates à demi exondées servent
de passerelle. Nulle part de gouffre, terreur des
mères lorsque les enfants s’absentent ; de
l’eau jusqu’aux genoux, pas plus. Cher ruisselet,
si frais, si limpide, si tranquille, j’ai vu
depuis des fleuves majestueux, j’ai vu la mer
immense. Rien dans mes souvenirs ne vaut tes
humbles cascatelles. Ton mérite est la sainte
poésie des premières impressions.
Un meunier s’est
avisé de faire travailler le ruisselet, qui s’en
allait si gai à travers les prairies. À mi-hauteur
du coteau, un canal, économisant la pente, dérive
une partie des eaux et les amène dans un grand
réservoir, dispensateur de la force motrice pour
les roues du moulin. Situé au bord d’un sentier
fréquenté, ce bassin se termine par le barrage
d’un mur.
Un jour, me
hissant sur les épaules d’un camarade, j’ai
regardé par-dessus la triste muraille, toute
barbue de fougères. Je vis des eaux mortes sans
fond, pleines de gluantes chevelures vertes. Dans
les trouées du visqueux tapis, paresseusement
nageait une sorte de lézard courtaud, noir et
jaune. Aujourd’hui je l’appellerais
Salamandre ; alors il me parut le fils de
l’Aspic et du Dragon, dont nos contes terrifiants
parlaient à la veillée. Brrr ! J’en ai assez
vu, redescendons vite.
Plus bas est le
ruisseau. Sur chaque rive, des aulnes et des
frênes, s’inclinant, emmêlent leurs ramées et
forment cintre de verdure. À leur base, derrière
un vestibule de grosses racines tordues, s’ouvrent
des retraites aquatiques que prolongent des
couloirs ténébreux. Sur le seuil de ces refuges
tremblote un peu de soleil découpé en ovales par
le tamis du feuillage.
Là stationnent
les Vairons cravatés de rouge. Avançons bien
doucement, couchons-nous à terre et regardons.
Qu’ils sont beaux, les petits poissons à gorge
écarlate ! Groupés à côté l’un de l’autre, la
tête tournée à l’inverse du courant, ils se
gonflent, ils se dégonflent les joues, ils se
rincent la bouche en des lampées sans fin. Pour se
maintenir immobiles dans l’eau qui fuit, rien
autre qu’un léger frisson de la queue et de la
nageoire du dos. Une feuille tombe de l’arbre.
Pst ! La bande a disparu.
Au-delà du
ruisseau est un bosquet de hêtres, aux troncs
lisses et droits, semblables à des colonnes. Dans
leur majestueuse ramée, pleine d’ombre, jacassent
des Corneilles, en se tirant de l’aile quelques
vieilles plumes remplacées par de nouvelles. Le
sol est matelassé de mousse. Dès les premiers pas
sur le moelleux tapis, un champignon est aperçu,
non étalé encore et pareil à un œuf laissé là par
quelque poule vagabonde. C’est le premier que je
cueille, le premier qu’entre mes doigts je tourne
et je retourne, m’informant un peu de sa structure
avec cette vague curiosité qui est l’éveil de
l’observation.
Bientôt d’autres
sont trouvés, différents de taille, de forme, de
coloration. C’est vrai régal pour mes yeux
novices. Il y en a de façonnés en clochette, en
éteignoir, en gobelet ; il y en a d’étirés en
fuseau, de creusés en entonnoir, d’arrondis en
demi-boule. J’en rencontre qui, à l’instant, se
colorent de bleu ; j’en vois de gros qui
s’effondrent en pourriture où grouillent des vers.
D’autres,
configurés en poires, sont secs et s’ouvrent au
sommet d’un trou rond, sorte de cheminée d’où
s’échappe un jet de fumée lorsque, du bout du
doigt, je leur tapote le ventre. Ce sont les plus
curieux. J’en remplis ma poche pour les faire
fumer à loisir, jusqu’à épuisement du contenu, qui
se réduit enfin en une sorte d’amadou.
Que de
distractions en ce bosquet de délices ! Bien
des fois j’y suis revenu depuis ma première
trouvaille ; là s’est faite, en compagnie des
Corneilles, ma première éducation en fait de
champignons. Mes récoltes, cela va de soi,
n’étaient pas admises à la maison. Le champignon,
ou le Boutorel, comme nous disions, y
avait mauvaise renommée, il empoisonnait les gens.
Sans plus ample informé, la mère le bannissait de
la table de famille. Je ne comprenais guère
comment le Boutorel, si avenant
d’aspect, avait telle malice mais enfin j’écoutais
l’expérience des parents, et jamais rien de
fâcheux ne m’est survenu de mes étourdies
relations avec l’empoisonneur.
Mes visites au
bois de hêtres se répétant, je parvins à répartir
mes trouvailles en trois catégories. Dans la
première, la plus nombreuse, le champignon avait
le dessous garni de feuillets rayonnants. Dans la
seconde, la face inférieure était doublée d’un
épais coussinet criblé de trous à peine visibles.
Dans la troisième, elle était hérissée de menues
pointes pareilles aux papilles de la langue du
chat. Le besoin d’ordre pour venir en aide à la
mémoire me faisait inventer une classification.
Bien plus tard
me tombèrent entre les mains certains petits
livres où j’appris que mes trois catégories
étaient connues ; elles avaient même des noms
latins, ce qui était loin de me déplaire. Ennobli
par le latin qui me fournissait mes premiers
thèmes et mes premières versions, glorifié par
l’antique langage dont faisait usage M. le
curé disant sa messe, le champignon grandissait en
mon estime. Pour mériter ainsi appellation
savante, il devait avoir réelle importance.
Les mêmes livres
me dirent le nom de celui qui m’avait tant amusé
avec sa cheminée fumante. Cela s’appelait Vesse-de-loup.
Le terme me déplut ; il sentait la mauvaise
compagnie. À côté se trouvait une dénomination
plus décente : Lycoperdon ;
mais ce n’était qu’apparence, car les racines
grecques m’apprirent un jour que Lycoperdon
signifie précisément vesse-de-loup. L’histoire des
plantes abonde en termes qu’il n’est pas toujours
convenable de traduire. Legs des anciens âges
moins réservés que le nôtre, la botanique a bien
des fois gardé la brutale franchise des mots
bravant l’honnêteté.
Qu’ils sont loin
ces temps bénis où ma curiosité d’enfant
s’exerçait, isolée, à la connaissance des
champignons ! Eheu ! fugaces
labuntur anni, disait Horace. Oh !
oui ; ils s’écoulent vite, les ans, alors
surtout qu’ils sont plus près de s’épuiser. Ils
étaient le gai ruisselet qui s’attarde parmi les
osiers sur des pentes insensibles ; ils sont
aujourd’hui le torrent, qui charrie mille débris
et se précipite vers l’abîme. Si fugaces qu’ils
soient, mettons-les à profit.
À la nuit
tombante, le bûcheron se hâte de lier ses derniers
fagots. De même, au déclin de mes jours, humble
bûcheron dans la forêt du savoir, j’ai souci de
mettre en ordre ma falourde. Que restera-t-il de
mes recherches sur les instincts ?
Apparemment peu de chose ; tout au plus
quelques fenêtres ouvertes sur un monde non encore
exploré avec toute l’attention qu’il mérite.
Les champignons,
mes délices botaniques depuis ma prime jeunesse,
auront destinée pire. Je n’ai cessé de les
fréquenter. Aujourd’hui encore, rien que pour
renouer connaissance avec eux, je vais, d’un pas
traînant, les visiter dans les beaux après-midi de
l’automne. J’aime toujours à voir émerger du tapis
rose des bruyères les grosses têtes des Bolets,
les chapiteaux des Agarics, les buissons corallins
des Clavaires.
À Sérignan, mon
étape finale, ils m’ont prodigué leurs séductions,
tant ils abondent sur les collines voisines,
boisées d’yeuses, d’arbousiers et de romarins. En
ces dernières années, telle richesse m’a inspiré
un projet insensé, celui de collectionner en
effigies ce qu’il m’était impossible de conserver
en nature dans un herbier. Je me suis mis à
peindre, de grandeur naturelle, toutes les espèces
de mon voisinage, des plus grosses aux moindres.
L’art de l’aquarelle m’est inconnu.
N’importe ; ce que je n’ai jamais vu
pratiquer, je l’inventerai, m’y prenant d’abord
mal, puis un peu mieux, puis bien. Le pinceau fera
diversion au tracas de la prose quotidienne.
Me voici
finalement en possession de quelques centaines de
feuilles où sont représentés, avec leur grandeur
naturelle et leur coloris, les divers champignons
des alentours. Ma collection a certaine valeur.
S’il lui manque la tournure artistique, elle a du
moins le mérite de l’exactitude. Elle me vaut le
dimanche des visiteurs, gens de la campagne, qui
naïvement regardent, ébahis que ces belles images
soient faites à la main, sans moule et sans
compas. Ils reconnaissent tout de suite le
champignon représenté ; ils me disent le nom
populaire, preuve de la fidélité de mon pinceau.
Or, que
deviendra cette haute pile d’aquarelles, objet de
tant de travail ? Sans doute les miens
garderont quelque temps la relique ; mais tôt
ou tard, devenue encombrante, déménagée d’un
placard dans un autre placard, d’un grenier dans
un autre grenier, visitée des rats et souillée de
maculatures, elle tombera entre les mains d’un
arrière-neveu qui, enfant, la découpera en carrés
pour faire des cocottes. C’est la règle. Ce que
nos illusions ont caressé avec le plus d’amour
finit de façon misérable sous les griffes de la
réalité...."