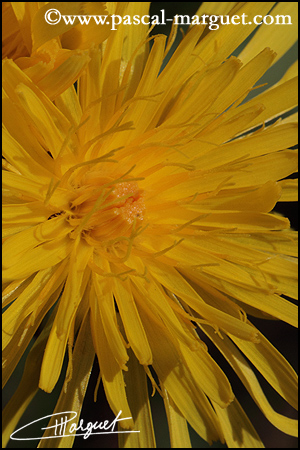Suggestion de
lecture :
"Sainte-Marine
Si je reviens au
village de mon enfance, ce village d'été où je suis
allé chaque année, sitôt l'école finie,
Sainte-Marine, je ne reconnais aujourd'hui à peu
près rien. La longue rue qui va de l'entrée vers la
pointe de Combrit est toujours bien là où elle
était, pas plus large ni rectiligne. Je vois la cale
du port, les vieilles maisons, l'abri du marin, la
chapelle mignonne. Tout est à la même place, mais
quelque chose a changé. Bien sûr le temps est passé,
sur moi et sur les maisons, le temps a usé et
repeint, a modifié l'échelle, a modernisé le
paysage. La route est goudronnée, et surtout
bariolée de peinture blanche, ces signalisations qui
tracent les places de stationnement, créent des
chicanes, des pointillés, des stops. On a construit
des ronds-points pour contrôler le flux des
voitures, des portiques en bois pour interdire le
passage des camping-cars, des panneaux pour
réglementer le stationnement, des bornes et des
arceaux pour l'interdire. Les cafés sont apparus,
les crêperies avec terrasses et parasols, les
magasins de cartes postales et de souvenirs. Tout
cela brille d'un vernis de modernité provinciale,
une sorte d'imperméabilisant pour rendre le village
étanche au temps, pour le protéger des atteintes
contre le passé, un vernis au tampon sur un meuble
d'antiquaire. Aujourd'hui on entre dans
Sainte-Marine en voiture, mais on ne s'y arrête pas.
L'été, le flot des visiteurs est si important qu'il
faut continuer sa route, aller jusqu'au cap,
peut-être le temps d'une photo, et revenir en
arrière. On entre, puis on s'en va. C'est ici
pourtant que j'ai vécu tous ces jours, chaque année,
chaque été, que j'ai rempli ma tête d'images, que
j'ai découvert mon enfance.
Difficile de
connecter le village d'hier à ce qu'il est devenu.
Bien sûr le monde a changé. Sainte-Marine n'est pas
le seul endroit. Comment se fait-il qu'ici cela
m'affecte davantage ? Quelle image ai-je gardée au
coeur, comme un secret précieux, dont la caricature
me trouble plus qu'aucune autre, me donne le
sentiment d'un trésor volé ?
Sainte-Marine,
c'était cette longue rue que nous abordions, ma
famille et moi, chaque été, venant du sud de la
France à bord de la Renault Monaquatre
antédilivienne de mes parents, pour trois mois de
vacances idéales, de liberté, d'aventure, de
dépaysement. Le coeur de Sainte-Marine, quand nous
arrivions, c'était moins la chapelle que la bac, cet
extraordinaire pont flottant de ferraille qui
glissait en grinçant deux fois par heure le long de
ses chaînes à travers l'estuaire de l'Odet. La
construction du gigantesque (et probablement
inutile) pont appelé pompeusement pont de
Cornouaille, en amont de l'estuaire, a été la cause
et l'évidence du changement. Au temps du bac, on ne
traversait as volontiers. C'était lent, bruyant,
cela sentait le cambouis et chachait les chaussures.
Et pour quoi faire ? Pour aller de l'autre côté de
la rivière, à Bénodet, où il n'y avait rien. Où tout
le monde se massait en été sur les plages, sur les
terrasses de café, dans les campings. De l'autre
côté, la modernité était déjà arrivée, et c'était
suffisant de l'imaginer de ce côté de la rive, et on
y tenait vraiment, de monter sur le bac avec les
camionnettes et les vélos. Ça ne coûtait rien, ça ne
rapportait pas grand-chose. Dans mon souvenir, une
petite pièce – cent sous aurait dit ma grand-mère.
Ou peut-être moins. Ou peut-être rien, pour des
gosses de dix ans qui sautaient sur le pont au
moment où le bac démarrait. La traversée durait dix
minutes, mais les jours de forte marée, ou quand le
vent soufflait, le bac tirait sur sa chaîne et
dérivait en grinçant dans l'estuaire, secoué par le
clapot de la mer et les remous du fleuve. De l'autre
côté, c'était un autre monde : Bénodet, en ce
temps-là, c'était la ville, le rendez-vous des
vacanciers, des campeurs. Passer de Sainte-Marine à
Bénodet, c'était franchir une frontière qui séparait
la Bretagne oubliée, traditionnelle, un peu
arriérée, du pays moderne, avec ses routes, ses
hôtels, ses cafés, ses cinémas, et surtout ses
plages couvertes de parasols, débordantes de
baigneurs. Je ne sais pas si ces choses-là sont
importantes pour les enfants. Je ne me souviens pas
d'avoir été très intéressé par la modernité, par le
bruit et la foule. Mais elles ont dû l'être pour les
adultes puisqu'ils ont décidé un jour que le vieux
bac rouillé et le long détour par les quais de
Quimper ne suffisaient plus et qu'il fallait
construire un pont pour laisser passer les voitures
et les touristes.
Le pont de
Cornouaille est magnifique. Je ne l'ai pas vu se
construire – à cette époque nous avions déjà cessé
d'aller en Bretagne. Le trajet depuis Nice était
trop long pour la vieille voiture et mon père avait
sans doute envie de voir autre chose. Et nous-mêmes
nous avions grandi, mon frère et moi, nous
préférions les mois d'été dans la touffeur de Nice,
ou bien aller dans le sud de l'Angleterre, à
Hasting, à Brighton, pour découvrir les milkbars
et les filles.
Des années plus
tard, je suis revenu, et j'ai emprunté le pont. Pour
le réaliser on a tracé un réseau de routes à trois
ou quatre voies, des ronds-points, des bretelles. Le
pont à cette époque était payant dans un sens,
gratuit dans l'autre (ce qui était notoirement
contraire à tous les usages en Bretagne). Autrement
dit, c'était une entreprise. Les banques avaient dû
s'en mêler. Sur le pont, on survole l'embouchure de
l'Odet, à la hauteur d'un vol de goéland. J'ai été
étonné de voir à quel point la hauteur de cette
construction avait rapetissé le paysage.
L'Odet, quand nous
voguions en plate en traînant une ligne, paraissait
grand comme l'Amazone, avec le mystère des rives
brumeuses, les tourbillons dans l'eau noire, et
l'ouverture sur la haute mer, vers les Glénan. C'est
devenu, à l'ombre du pont, un bras d'eau tranquille,
provincial, étriqué, moucheté de petits bateaux
blancs attachés à des corps morts. En quelques
années, l'estuaire sauvage s'est transformé en
parking à plaisanciers, une sorte d'esplanade d'eau
verte encadrée de maisons et d'arbres, une ria. J'ai
essayé d'imaginer l'impression que cela pouvait
faire à deux gosses occupés à godiller entre les
jambes du pont, sous le grondement répétitif des
autos en train de franchir l'estuaire à soixante
kilomètres à l'heure, à trente-cinq mètres de
hauteur. Cela a pris un air urbain, définitif, c'est
puissant et inamovible comme un barrage. Je ne suis
jamais retourné sur le pont.
Si j'essaie de
reconstituer la Sainte-Marine de mon enfance, c'est
d'abord la rue qui m'apparaît, cette très longue rue
de terre graveleuse qui partait de l'entrée du
village, près de l'école, et conduisait jusqu'à la
pointe, avec, de chaque côté, les maisons alignées.
Cela devait me paraître normal, mais c'était déjà un
habitat composé, métis je voudrais dire. Alternance
de maisons bretonnes, la plupart pauvres, bâties en
pierres mais crépies de ciment gris, avec leurs
volets rustiques, les portes basses parfois décorées
de linteaux, les toitures d'ardoise moussue avec les
chaînons de faîtage visibles, les cheminées de
brique. Certaines si pauvres et si anciennes
qu'elles avaient toujours leurs murs de granite,
leurs fenêtres étroites et leurs toits de chaume.
Elles protégeaient à l'arrière des jardinets plantés
d'ails et d'oignons, des haricots, des patates. Et,
au beau milieu de tout cela, arrogantes et
prétentieuses, les villas des
« Parisiens » avec de grands parcs donnant
sur les rives de l'Odet, cernées de hauts murs de
pierre qui laissaient apercevoir les pignons et les
tours, et de lourds portails de fer forgé peints en
vert sombre, ouverts sur des allées de gravillon
blanc, avec plates-bandes fleuries, massifs
d'hortensias bleus, buissons de camélias.
Ce qui faisait de
Sainte-Marine un village à part, c'était l'absence
de commerces, sans doute par défaut plutôt que par
goût du luxe (quoi de plus luxueux aujourd'hui
qu'une rue sans boutiques ?), parce que de fait
chacune de ces maisons modestes était un endroit où
on pouvait acheter, selon l'occasion, un poisson,
des crevettes, un crabe, ou simplement quelques
légumes terreux arrachés au jardin. L'unique
boutique digne de ce nom, c'était un magasin à tout
vendre, qui appartenait à la ferme Biger (de
Poulopris). On y entrait de plain-pied, juste en
poussant la porte munie d'une sonnette aigrelette,
et on achetait ce qu'on trouvait : des conserves (du
lait condensé, des sardines en boîte, des petits
pois), du vin au litre (du vin d'Algérie qui portait
le nom étrange d'Allah Allah, ce qui alors ne
choquait personne), des légumes secs en vrac, et des
choses aussi indispensables que des rouleaux de
papier hygiénique, des allumettes (et des
cigarettes), et surtout, ce qui m'émerveillait, de
la confiture gélifiée vendue à la louche, dont je
n'ai pas oublié le goût, même si je suis incapable
de dire s'il était de la pomme, du raisin ou du
coing. La boutique Biger était aussi l'unique dépôt
de pain, des miches définitivement industrielles
fabriquées à Quimper, toujours dures et rassies à
tel point que les gosses chargés de les ramener à la
maison s'en servaient comme de tabourets pour se
reposer le long du chemin. Mes parents en achetaient
rarement, ayant décidé une fois pour toutes qu'il
valait mieux manger des crêpes que cet affreux pain
trop blanc.
L'un des points
névralgiques de Sainte-Marine, non loin de la maison
Biger, c'était la pompe communale. Elle était
chargée officiellement de fournir l'eau potable aux
habitants. Chaque maison, chaque ferme était pourvue
d'un puits ou d'un réservoir à eau de pluie en
pleine terre, mais le voisinage du purin et des
fosses septiques rendait l'eau dangereuse à
consommer. L'eau des gouttières alimentait aussi des
bassins, mais les toitures imprégnées d'embruns
donnaient une eau saumâtre, tout juste bonne à se
laver, ou à laver le linge. Les champs alentour
avaient commencé à être copieusement arrosés de
produits chimiques pour lutter contre l'invasion des
parasites, notamment les doryphores dont il sera
question plus loin. Les fermes d'élevage de poules
et de porcs n'avaient pas la dimension qu'elles ont
aujourd'hui - dans certains endroits, ce sont des
poulaillers de deux cent mille poules ! - mais leurs
déjections avaient commencé à élever le taux de
nitrates. Nous n'avions pas atteint les niveaux de
pollution actuels, mais on s'en approchait. Du
reste, il n'existait pas encore d'eau en bouteille -
sauf peut-être pour les nourrissons, et cette autre
engeance délicate venue passer les vacances et qui
devait en apporter des cargaisons dans ses autos. On
ne trouvait ni filtres, ni réglementation officielle
affichée au-dessus de la pompe.
L'unique source
d'eau potable était donc cette pompe à bras, au bord
de la route, qui puisait l'eau dans un puits profond
relativement préservé. C'était notre tâche, à nous
les enfants, et à tous les enfants du village,
d'aller deux fois par jour chercher l'eau à la
pompe. Lorsque je suis retourné visiter
Sainte-Marine, dix ans plus tard, j'ai constaté que
la pompe était toujours là, mais hors d'usage,
verrouillée, peinte en vert pomme. Devenue un objet
décoratif, une sorte de fétiche du temps jadis, pour
les nostalgiques, au même titre que les rouages des
chaînes du bac ou les bornes kilométriques. Ornée de
bouquets de fleurs, comme une vieille brouette dans
un jardin.
Du temps de mon
enfance, la pompe servait, et comme tout ce qui sert
elle n'avait pas de couleur, elle était du gris
sombre de la fonte, marquée par la rouille à
certains endroits, tachée de graisse autour du
piston. Le bras était poli par toutes les mains qui
la manoeuvraient. Elle grinçait quand on
l'actionnait, avec un certain délai elle rejetait un
mince filet d'eau froide intermittent qui
remplissait lentement les brocs. Quand le broc était
plein à ras bord - il s'agissait de ces grands brocs
en zinc ou en métal émaillé bleu qui contenaient
cinq ou six litres - il fallait le ramener à la
maison. Nous marchions lentement, le bras tendu pour
éviter les cahots, à tour de rôle, avec des arrêts
fréquents pour calmer la brûlure des tendons du
poignet et du coude. Entre la pompe et Ker Huel (la
maison de vacances que louaient nos parents à Mme
Hélias), il ne devait pas y avoir un kilomètre, mais
peu de trajets m'ont paru aussi longs ! Cette eau
précieuse, mon père la mettait à bouillir sur le
réchaud à butane, dans une grande casserole émaillée
qui ne servait qu'à cela, et l'évaporation diminuait
la provision d'eau et nous rapprochait du voyage
vers la pompe. On dit souvent que la corvée d'eau
est une activité distrayante dans la vie des enfants
du village, que le point d'eau bruisse du rire des
filles et des cris des garçons. Ce n'est pas
exactement le souvenir que j'en ai. Je me souviens
plutôt de l'interminable chemin entre les maisons,
sous le soleil, et de la colonne des gosses en train
de rapporter les brocs, un peu penchés de côté pour
faire contrepoids, et des clapots de l'eau précieuse
qui jaillissait des brocs. Mais en fin de compte
c'était une activité plutôt agréable, car cela
donnait aux enfants, j'imagine, le sentiment d'être
utiles. Aujourd'hui, bien sûr, c'est plus simple de
tourner le robinet, à la cuisine, ou à la salle de
bains, et de regarder l'eau couler. Mais encore à
présent, je ne peux m'empêcher de veiller à ce que
les robinets soient bien fermés, pour ne pas laisser
perdre une goutte du précieux liquide..."