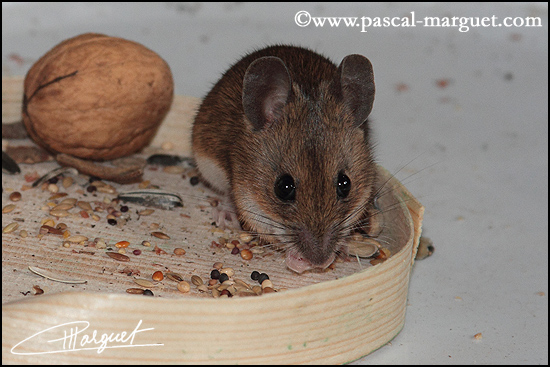Suggestion de
lecture :
"C'était une grande surprise pour moi d'être
aveugle. Car cela ne ressemblait à rien de ce que je
pouvais imaginer. Cela ne ressemblait pas davantage
à ce que les gens autour de moi semblaient penser
que c'était. On me disait qu'être aveugle, cela
consistait à ne pas voir. Je ne pouvais pas croire
les gens, car moi je voyais.
Pas tout de suite,
c'est vrai. Pas dans les jours qui ont suivi
immédiatement l'opération. Car alors je voulais
encore me servir de mes yeux. J'allai dans leur
direction. Je cherchais dans le sens où, avant
l'accident, j'avais l'habitude de voir. Et cela
faisait une peine, un manque, quelque chose comme un
vide. Cela me donnait ce que les grandes personnes
appellent le désespoir, je suppose.
Enfin, un jour (et
ce jour vint très vite), je m'aperçus que je
regardais mal, tout simplement. Je faisais à peu
près l'erreur qu'une personne qui changeait de
lunette ferait si elle ne s'habituait pas à
accommoder d'une façon nouvelle.Au fond, je
regardais trop loin, et je regardais trop vers
l'extérieur.
Ce fut beaucoup
plus qu'une découverte : ce fut une révélation. Je
me revois encore dans le Champ-de-Mars où, quelques
jours après mon accident, mon père m'avait emmené en
promenade. Je connaissais bien ce jardin. Je
connaissais ses bassins, se grilles, ses chaises de
fer. Je connaissais même en personne quelques-uns de
ses arbres. Et bien sûr c'étaient eux que je voulais
revoir, et que je ne voyais plus. Je crus un instant
le monde perdu. Je jetai mes yeux en avant comme des
mains, dans le vide. Rien ne s'approchait plus, rien
ne s'éloignait plus de moi. Les distances exténuées
se chevauchaient ; elles ne jalonnaient plus
l'espace de leurs petits rayons clignotants. Tout
semblait épuisé, éteint, et je fut pris de peur. Je
me jetais en avant dans une substance qui était
l'espace, mais que je ne reconnaissais pas car rien
d'accoutumé ne l'emplissait plus.
C'est alors qu'un
instinct (j'allais presque dire : une main se posant
sur moi) m'a fait changer de direction. Je me suis
mis à regarder de plus près. Non pas plus près des
choses mais plus près de moi. A regarder de
l'intérieur, vers l'intérieur, au lieu de m'obstiner
à suivre le mouvement de la vue physique vers le
dehors. Cessant de mendier aux passants le soleil,
je me retournai d'un coup et je le vis de nouveau :
il éclatait là dans ma tête, dans ma poitrine,
paisible, fidèle. Il avait gardé intacte sa flamme
joyeuse : montant de moi, sa chaleur venait battre
contre mon front. Je le reconnus, soudain amusé, je
le cherchais au-dehors quand il m'attendait chez
moi.
Il était là. Mais
il n'était pas seul. Les maisons et leurs petits
personnages l 'avaient suivi. Je vis aussi la tour
Eiffel et ses pattes tendues du haut du ciel, l'eau
de la Seine et ses traînées d'ombres brillantes, les
petits ânes que j'aimais sous leurs housses, mes
jouets, les boucles des filles, les chemins de mes
souvenirs... Tout était là, venu je ne savais d'où.
On ne m'avait rien dit de ce rendez-vous de
l'univers chez moi ! Je tombais, ravi, au milieu
d'une conversation surprenante. Je vis la bonté de
Dieu et que jamais rien, sur son ordre, ne nous
quitte.
La substance de
l'univers s'était condensée à nouveau, s'était
redessinée et repeuplée. J'ai vu un rayonnement
partir d'un lieu dont je n'avais aucune idée, qui
pouvait être aussi bien hors de moi qu'en moi. Mais
un rayonnement ou, pour être plus exact, une
lumière, la Lumière.
C'était une
évidence : la lumière était là.
Je me mis à
éprouver un soulagement indicible, un contentement
si grand que j'en riais. Le tout accompagné de
confiance et de gratitude comme le serait une prière
exaucée.
Je découvrais dans
le même instant la lumière et la joie. Et je puis
dire sans hésiter que lumière et joie ne sont jamais
plus séparées dans mon expérience depuis lors. Je
les ai eues ensemble, ou je les ai perdues ensemble.
Je voyais la
lumière. Je la voyais encore quoique aveugle. Et je
le disais. Mais je n'ai as dû le dire avec beaucoup
de force pendant des années. Je me souviens que,
jusque vers l'âge de quatorze ans, j'ai donné à
cette expérience qui recommençait à chaque seconde
en moi un nom : je l'appelais « mon
secret ». Et je n'en parlais qu'à mes amis les
plus intimes. Je ne sais pas s'ils me croyaient,
mais ils m'écoutaient, étant mes amis. Et puis ce
que je racontais avait pour eux un mérite bien plus
grand que celui d'être vrai : celui d'être beau.
C'était un rêve, c'était un enchantement, c'était
comme une magie.
L'étonnant c'était
que pour moi ce n'était pas du tout une magie, mais
la chose la plus immédiate : celle que, quoi qu'on
fît, je n'aurais pas pu nier, pas plus que ceux qui
ont leurs yeux ne peuvent nier qu'ils voient.
Je n'étais pas la
lumière : de cela je me rendais bien compte. Je
baignais dans la lumière. Elle était un élément dont
la cécité m'avait tout à coup rapproché. Je pouvais
la sentir naître, se répandre, se poser sur les
choses, leur donner forme et se retirer.
Se retirer, oui.
Diminuer en tout cas. Car, à aucun moment, il n'y
avait le contraire de la lumière. Les voyants
parlent toujours de la nuit de la cécité. De leur
part, cela est bien naturel. Mais cette nuit-là
n'existe pas. A toutes les heures de ma vie
consciente – et jusque dans mes rêves – je vivais
dans une continuité lumineuse.
Sans les yeux,
d'autre part, la lumière était beaucoup plus stable
qu'elle ne l'était avec les yeux. Il n'y avait plus
ces différences, dont j'avais encore à ce moment le
souvenir le plus net, entre les objets éclairés,
ceux qui l'étaient moins, ou ceux qui ne l'étaient
pas. Je voyais l'univers comme étant tout entier
dans la lumière, existant par elle, à cause d'elle.
Les couleurs –
toutes les couleurs du prisme – subsistaient elles
aussi. C'était pour moi – l'enfant crayonneur et
barioleur – une fête si inattendue que je passais de
longs temps à jouer avec ces couleurs. D'autant
mieux qu'elles étaient plus dociles qu'autrefois.
La lumière faisait
ses couleurs sur les choses, et sur les êtres aussi.
Mon père, ma mère, les gens croisés ou heurtés dans
la rue, tous avaient une présence colorée que je
n'avais jamais vue avant de devenir aveugle. Mais
qui maintenant s'imposait à moi comme une part
d'eux-mêmes aussi inséparable d'eux que pouvait
l'être leur visage.
Pourtant les
couleurs n'étaient qu'un jeu, tandis que la lumière
était ma raison d'être. Je la laissais monter en moi
comme le puits laisse monter son eau, et je me
réjouissais sans plus finir.
Je ne comprenais
pas ce qui m'arrivait. C'était si parfaitement
contraire à tout ce que j'entendais dire. Je ne le
comprenais pas, mais cela m'était bien égal, car je
le vivais. Et, pendant des années, je n'ai pas
essayé de savoir pourquoi ces choses se passaient en
moi. Je n'ai fait cette tentative que beaucoup plus
tard, et il n'est pas encore temps de la dire.
Une lumière
pareille, si continue et si intense, cela dépassait
tellement ma raison qu'il m'arrivait d'avoir des
doutes sur elle. Si elle n'était pas réelle ! Si je
l'avais seulement imaginée ! Peut-être alors
suffirait-il d'imaginer le contraire, ou simplement
autre chose, pour que d'un seul coup elle s'en
allât. Aussi eus-je l'idée de la mettre à l'épreuve,
et même de lui résister.
Le soir, dans mon
lit, quand j'étais bien seul, je fermais les yeux.
J'abaissais mes paupières, comme je l'aurais fait
autrefois, du temps qu'elles couvraient mes yeux
physiques. Je me disais que, derrière ces rideaux,
je ne verrais plus la lumière. Or elle était
toujours là, et plus calme que jamais : elle prenait
l'apparence de l'eau d'un lac le soir après que le
vent est tombé.
Alors je ramassais
toutes mes énergies, toute ma volonté : j'essayais
d'arrêter le courant de lumière exactement comme
j'aurais essayé d'arrêter ma respiration.
Il en résultait
aussitôt un trouble, ou plutôt un tourbillon. Mais
ce tourbillon était lumineux. De toutes façons je ne
pouvais pas maintenir cet effort bien longtemps :
deux, trois secondes peut-être. Je ressentais en
même temps une angoisse, comme si j'étais juste en
train de faire quelque chose d'interdit, quelque
chose de contraire à la vie. Tout se passait comme
si j'eusse besoin pour vivre de la lumière au même
titre que l'air.
Pas moyen d'en
sortir vraiment : j'étais prisonnier de ces rayons,
j'étais condamné à voir. Tout se passait en moi.
L'espace peut à peu s'était vidé de son contenu :
les flots de couleur qu'il transporte, chassés du
dehors, refluaient, venaient se briser en moi. Là,
tout d'abord, ils ne rencontraient rien sur quoi se
fixer : ils s'étalaient en nappes paresseuses,
parcouraient d'une extrémité à l'autre,
capricieusement, le champ entier de ma conscience.
Des taches troubles naissaient çà et là, et des
cercles et des figures sans visage, et des ébauches
de formes imprévues. Puis de courtes scènes
prenaient vie : des rampes de petits feux clairs,
des gouttes de soleil couraient en lignes
transversales. Il pleuvait partout de la clarté :
plus un reste de nuit. Tout était d'or et d'argent
comme si, des couleurs, je n'avais su d'abord
accueillir que les plus aigües, les plus
précipitées... Au-dehors, c'était désormais le vide
; au-dedans, toute une forêt de lumière. Je dus
regarder longtemps avant de m'accoutumer à cette
lumière sans ombre.
[...]
9
La première salle
de concert où je sois entré, à huit ans, fut à elle
seule, pour moi, en une minute, plus que tous les
royaumes de légende.
Le premier
musicien que j'y entendis, là, devant moi, à
quelques pas de mon fauteuil d'orchestre, fut un
autre enfant : Yehudi Menuhin.
Chaque samedi,
d'octobre à mai, pendant six ans, mon père est venu
me chercher à la sortie du lycée, a hélé un taxi et
m'a conduit à l'un des concerts que donnaient à
Paris les grandes associations symphoniques.
Paul Paray, Felix
Weingartner, Charles Munch, Arturo Toscanini, Bruno
Walter m'étaient devenus si familiers que je savais,
sans qu'on eût besoin de me le dire, qui, ce
jour-là, était au pupitre. L'orchestre prenait le
pas Munch, le pas Toscanini. Qui s'y tromperait ?
L'entrée dans la
salle était le premier épisode d'une histoire
d'amour. L'accord des instruments : c'étaient mes
fiançailles. Après, je me jetais dans la musique
comme on se roule dans le bonheur.
Le monde des
violons et des flûtes, des cors et des violoncelles,
des fugues, des scherzos et des gavottes, obéissait
à des lois si belles et si claires que toute musique
semblait parler de Dieu. Mon corps n'écoutait pas :
il priait. Mon esprit n'avait plus de limites. Et si
des larmes me montaient aux yeux, je ne les sentais
pas couler : elles étaient hors de moi. Je pleurais
de reconnaissance chaque fois que l'orchestre
commençait à chanter.
Un univers de
sons, pour un aveugle, quelle grâce soudaine ! Plus
besoin de s'orienter. Plus besoin d'attendre. C'est
le monde intérieur devenu objet.
J'ai tant aimé
Mozart, j'ai tant aimé Beethoven qu'à la fin ils
m'ont fait ce que je suis. Ils ont modelé mes
émotions, ils ont conduit mes pensées. Ai-je en moi
quelque chose que je n'aie pas reçu d'eux un jour ?
J'en doute.
Aujourd'hui, pour
moi la musique pend à un clou d'or qui porte le nom
de Bach. Mais ce ne sont pas mes goûts qui ont
changé : ce sont mes relations. Dans mon enfance, je
vivais avec Mozart, Beethoven, Schumann, Berlioz,
Wagner et Dvorak, parce que c'étaient eux que je
rencontrait chaque semaine. Avant d'être la parole
d'un homme – cet homme fût-il même Mozart -, toute
musique est musique.
Géométrie, mais de
l'espace intérieur. Phrases, mais libérées du sens.
Sans aucun doute, de toutes les créations humaines,
la musique était la moins humaine. Si je
l'entendais, j'étais là tout entier, avec mes peines
et mes plaisirs, pourtant ce n'était pas moi tout à
fait : c'était mieux que moi, c'était plus grand,
c'était plus sûr.
La musique pour un
aveugle est une nourriture, comme pour ceux qui
voient, la beauté. Il faut qu'il la reçoive, il faut
qu'on la lui donne périodiquement, comme une
nourriture. Sans quoi, un vide se creuse en lui, et
qui fait mal.
Mon père avait
l'habitude de rentrer du concert à pied jusqu'à la
maison, me faisant ainsi cadeau de quelques-unes des
plus belles heures de mon enfance.
Comment les gens
peuvent-ils appeler la musique un plaisir ? Un
plaisir satisfait vous appauvrit, vous attriste. Une
musique entendue vous construit.
Au bras de mon
père, j'étais plein de son, dirigé par les sons. Mon
père sifflotait, il chantonnait une mélodie. Il me
parlait du concert. Il me parlait de toutes les
choses qu'il y aurait un jour pour moi dans la vie :
il n'avait plus besoin de me les expliquer.
L'intelligence, le courage, la franchise, les
conditions du bonheur et de l'amour, toutes ces
choses étaient dans Haendel, dans Schubert,
entièrement dites, lisibles comme le soleil du haut
du ciel à midi. Ah ! Si tous les pères partageaient
avec leur fils, comme le mien savait le faire,
quelque chose de plus qu'eux-mêmes, la vie
deviendrait meilleure !
Et maintenant –
qui le croirait ? - je n'étais pas musicien. Pas
vraiment.
J'appris à jouer
du viloncelle. Pendant huit ans, je fis des gammes,
des exercices. J'inteprètai même décemment quelques
morceaux simples. Je fis partie un jour d'un trio et
je parvins à ne pas le détruire tout à fait. Mais la
musique n'était pas ma langue. Je savais l'entendre
à merveille, jamais je ne saurais la parler.
La musique est
faite pour les aveugles. Mais il est des aveugles
qui ne sont pas fait pour elle : j'étais de ceux-là,
j'étais un aveugle visuel.
Je ne devenais pas
un musicien, et la raison en était drôle : à peine
avais-je formé un son sur les cordes de la,
de ré, de
sol ou de do que déjà je
ne l'écoutais plus. Je le regardais.
Sons, accords,
mélodies, rythmes, tout se transformait
immédiatement en images, en courbes, en lignes, en
figures, en paysages et, par-dessus tout, en
couleurs.
Quand, de
l'archet, je faisais résonner à vide la corde de la, il se
faisait devant mes yeux un tel éclatement de lumière
et si prolongé que je devais souvent m'arrêter de
jouer.
Au concert,
l'orchestre pour moi était peintre : il m'inondait
de toutes les couleurs du prisme.
Si le violon
entrait en solo, j'étais empli soudain d'or et de
feu, et d'un rouge si clair que je ne pouvais pas me
souvenir de l'avoir vu posé sur un objet réel. Quand
c'était le hautbois, un vert limpide m'envahissait
tout entier, et si frais qu'il me semblait sentir
sur moi le souffle de la nuit.
Je visitais le
pays de la musique. J'arrêtais mes yeux sur chacun
de ses spectacles. Je l'aimais à perdre haleine.
Mais je voyais trop la musique pour pouvoir parler
sa langue. Ma langue à moi était celle des formes.
Curieuse chimie,
qui transformait une symphonie en intention morale,
un adagio en poème, un concerto en promenade,
accrochait les mots aux images, les images aux mots,
barbouillait l'univers de couleurs, enfin faisait de
la voix humaine le plus beau de tous les instruments
!
J'avais avec Jean
qui, lui, était musicien plus que moi, de longs
débats à ce sujet. Ils se terminaient tous par une
découverte exaltante, toujours la même : qu'il n'est
pas une chose au monde qui ne puisse être remplacée
par une autre, que les sons et les couleurs
s'échangent sans arrêt, comme l'air que nous
respirons et la vie qu'il nous donne, que rien n'est
jamais solitaire, jamais perdu, que tout vient de
Dieu et retourne à Dieu au long de tous les chemins
du monde, et que la plus belle musique n'est encore
qu'un chemin.
Seulement il est
des routes enchantées, et celle dont les étapes
portent les noms de Vivaldi, de Beethoven ou de
Ravel conduisait plus loin, je le savais bien, que
les routes de la terre...
[...]
Il restait, c'est
entendu, des situations incompréhensibles. L'abus
que l'on faisait, sur la scène de la
Comédie-Française, de l'adultère, de la mégalomanie,
du meurtre prémédité, du cocuage et de l'inceste, me
laissait rêveur. Quand, par miracle, il restait
assez d'argent à mon camarade et à moi pour nous
payer la folie d'un verre de bière après le
spectacle, ces grands problèmes, autour de la table
du bistrot, prenaient l'allure d'une conspiration.
Nous étions alors d'avis que le monde était une
affaire inquiétante, mais sans aucun doute plus
extraordinaire que tout Racine et tout Shakespeare.
Nous étions tellement pressés d'y aller voir par
nous-mêmes que nous rentrions chez nous en courant.
En ce temps-là, la
Comédie-Française dédaignait quelque peu
Shakespeare. Il est remarquable que l'amour de
Shakespeare a toujours été en France sujet à
éclipses, comme si les Français étaient
périodiquement mécontents de rencontrer un si grand
bonhomme hors de chez eux.
Cependant, à la
radio, un soir, j'étais tombé sur une représentation
d'Hamlet.
Je me souviens précisément que je n'avais rien
compris, mais j'étais resté fasciné.
C'était aussi
convaincant que du Racine, avec de la brume en plus,
du brouillard partout, entre les vers, entre les
scènes, avec des personnages dont on ne savait
jamais très bien où ils étaient ni quels noms il
fallait leur donner : fou ou raisonnable ? Ambitieux
ou bon ? L'équivoque anglaise me semblait plus vraie
que toutes les définitions françaises.
J'avais découvert
en Shakespeare un esprit enfin aussi compliqué que
la vie. Je me mis à le lire tout entier en
traduction. Mettre en scène Shakespeare dans sa
tête, c'était une telle réjouissance ! Il vous
aidait si bien ! Il déversait sur vous toute l'ombre
et tout le soleil, les chants des oiseaux et les
gémissements des fantômes. Il ne vous disait pas une
seule chose abstraite. Plus besoin ici d'imaginer
Roméo ni Juliette : on les touchait. On se croyait
soi-même Roméo.
Finies, les
petites ou même les grandes mesures de
l'intelligence, ce qui est convenable et ce qui ne
l'est pas. Le probable et l'improbable se
mélangeaient, comme ils doivent le faire, comme ils
le font dans la réalité.
Shakespeare était
plus grand que les autres, parce qu'il avait ce que
je cherchais partout en vain dans le théâtre
classique français : l'excès divin..."