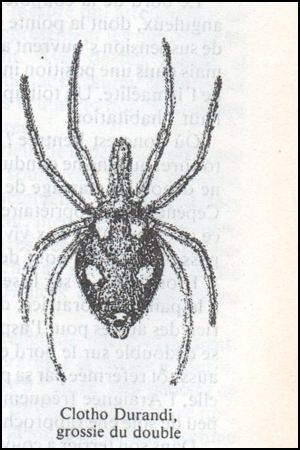Suggestion de
lecture :
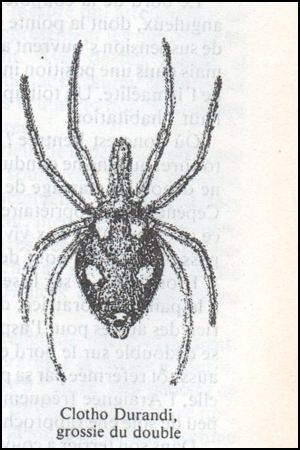
"CHAPITRE
XVI
L’ARAIGNÉE CLOTHO
Celle-ci
s’appelle Clotho de Durand (Clotho Durandi Latr.),
en souvenir de celui qui, des premiers, appela
l’attention sur cette Aranéide. S’en aller dans
l’éternité avec le sauf-conduit d’une petite bête
qui sauvegarde de l’oubli, si vite venu sous les
roquettes et les mauves, n’est pas avantage à
dédaigner. La plupart disparaissent sans laisser
un écho qui répète leur nom ; ils sont
ensevelis dans l’oubli, la pire des sépultures.
D’autre, parmi
les naturalistes, afin de surnager un peu, ont
pour esquif la dénomination donnée à tel ou tel
autre objet des trésors de la vie. Une croûte de
lichen sur les vieilles écorces, un brin d’herbe,
une frêle bestiole transmettent un nom à l’avenir
aussi vaillamment que le ferait un nouvel
astéroïde. Malgré ses abus, elle est infiniment
respectable, cette façon d’honorer les disparus.
Pour graver une épitaphe de quelque durée, où
trouver mieux que l’élytre d’un scarabée, la
coquille d’un colimaçon, la toile d’une
araignée ? Le granit ne les vaut pas. Confiée
à la pierre dure, une inscription s’efface,
confiée à l’aile d’un papillon, elle est
indestructible. Donc, va pour Durand.
Mais que vient
faire ici Clotho ? Est-ce par caprice de
nomenclateur, à court de syllabes pour dénommer le
flot toujours montant des bêtes à
cataloguer ? Pas tout à fait. Un nom
mythologique lui est venu à l’esprit, sonnant
bien, et par surcroît non déplacé dans la
désignation d’une filandière. L’antique Clotho est
la plus jeune des trois Parques ; elle tient
la quenouille où se filent nos destinées,
quenouille garnie de bourre sauvage en abondance,
de quelques brins de soie, et bien rarement d’un
maigre fil d’or.
Gracieuse de
forme et de costume autant que peut l’être une
Araignée, la Clotho des naturalistes est, avant
tout une filandière de haut talent, et tel est le
motif qui lui a valu le nom de l’infernale
divinité porteuse de quenouille. Il est fâcheux
que l’analogie ne s’étende pas plus loin. La
Clotho mythologique, très avare de soie et
prodigue de bourre grossière, nous file une rude
vie ; la Clotho à huit pattes ne fait usage
que de la soie exquise ; elle travaille pour
elle, l’autre travaille pour nous, qui n’en valons
guère la peine.
Désirons-nous
faire sa connaissance ? Sur les pentes
rocailleuses que le soleil calcine au pays de
l’olivier, retournons les pierres plates, de
quelque largeur ; visitons surtout les amas
que les bergers dressent pour se faire un siège et
surveiller de haut les moutons paissant parmi les
lavandes. Ne nous laissons pas décourager ;
la Clotho est rare, tous les cantonnements ne lui
conviennent pas. Si la bonne fortune sourit enfin
à notre persévérance, nous verrons, adhérant à la
face inférieure de la pierre soulevée, un édifice
d’extérieur fruste, en forme de coupole renversée,
du volume à peu près d’une moitié d’orange
mandarine. À la surface sont incrustés ou
pendillent de menus coquillages, des parcelles de
terre, et surtout des insectes desséchés.
Le bord de la
coupole rayonne en une douzaine de prolongements
anguleux, dont la pointe épanouie se fixe à la
pierre. Entre ces lanières de suspension s’ouvrent
autant de spacieuses arcades renversées. C’est,
mais dans une position inverse, la demeure en poil
de chameau, la tente de l’Ismaélite. Un toit
aplati, tendu entre les lanières d’attache, clôt
en haut l’habitation.
Où donc est
l’entrée ? Toutes les arcades du bord
s’ouvrent sur la toiture, aucune ne conduit à
l’intérieur. En vain le regard explore, rien ne
dénote un passage de communication entre le dedans
et le dehors. Cependant la propriétaire de la case
doit sortir de temps à autre, ne serait-ce que
pour aller aux vivres ; sa tournée faite,
elle doit rentrer. Par où passe-t-elle ? Un
bout de paille va nous dire le secret.
Promenons-le sur
le seuil des diverses arcades. De partout
résistance à la paille exploratrice, de partout
rigoureuse clôture. Ne différant en rien des
autres pour l’aspect, un seul des festons,
adroitement sollicité, se dédouble sur le bord en
deux lèvres et bâille un peu. Voilà la porte,
aussitôt refermée par sa propre élasticité. Ce
n’est pas tout : rentrée chez elle,
l’Araignée fréquemment met les verrous,
c’est-à-dire qu’avec un peu de soie elle rapproche
et maintient fixes les deux battants de l’huis.
Dans son terrier
à couvercle non distinct du sol et mobile autour
d’une charnière, la Mygale maçonne n’est pas mieux
en sécurité que la Clotho dans sa tente,
inviolable pour tout ennemi non au courant de la
méthode. En péril, celle-ci vite accourt chez
elle ; d’un coup de griffette, elle fait
bâiller la fissure ; elle entre, elle
disparaît. La porte se ferme d’elle-même, munie au
besoin d’une serrure de quelques fils. Jamais
larron, dérouté par la multiplicité des arcades,
toutes pareilles, ne découvrira comment la
poursuivie a disparu soudain.
D’ingéniosité
plus simple en mécanisme défensif, la Clotho est
incomparablement supérieure à la Mygale sous le
rapport du bien-être chez soi. Ouvrons sa cabine.
Quel luxe ! On raconte qu’un Sybarite de
l’antiquité ne pouvait reposer, se sentant blessé
dans son lit par le pli d’une feuille de rose. La
Clotho n’est pas moins exigeante. Comme finesse,
sa couchette est mieux que le duvet du cygne, et
comme blancheur, mieux que le coton des nuées où
couvent les orages d’été. C’est l’idéal du
molleton. Au-dessus est un ciel de lit de même
souplesse. Entre les deux, bien à l’étroit, repose
l’Araignée, courte de pattes, costumée de sombre,
avec cinq cocardes jaunes sur le dos.
Le repos en cet
exquis réduit exige stabilité parfaite, surtout
les jours de tourmente, lorsque des vents coulis
pénètrent sous la pierre. Cette condition est des
mieux remplies. Promenons un regard attentif sur
l’habitation. Les festons qui cernent la toiture
d’une balustrade et supportent le poids de
l’édifice se fixent à la dalle par leur extrémité.
En outre, de chaque point d’attache part un
faisceau de fils divergents, qui rampent sur la
pierre, y adhèrent dans toute leur longueur et se
prolongent à de grandes distances. J’en ai mesuré
qui atteignaient un empan. Ce sont des câbles
d’ancrage ; ils représentent les piquets et
les cordes qui stabilisent la tente du Bédouin.
Avec de tels appuis, si nombreux et si
méthodiquement disposé, le hamac ne saurait être
arraché de sa base, à moins que n’interviennent
des brutalités dont l’Araignée n’a pas à se
préoccuper, tant elles sont rares.
Un autre détail
attire l’attention. Si l’intérieur de la demeure
est d’une délicieuse propreté, l’extérieur abonde
en souillures, lopins de terre, miettes de bois
pourri, menus graviers. Fréquemment il y a
pire ; le dehors de la tente devient un
charnier. Là se trouvent, incrustés ou suspendus,
des cadavres secs d’Opâtres, d’Asides et autres
Ténébrionides amis des abris sous roche ; des
tronçons d’Iule blanchis au soleil, des coquilles
de Pupa, hôte des pierrailles, enfin des Hélices
choisies parmi les moindres.
Pour la majeure
part, ces reliques sont des reliefs de table
évidemment. Non versée dans l’art des lacets, la
Clotho pratique la chasse à courre, et se nourrit
de la bohème errant, d’une pierre à l’autre. Qui
pénètre de nuit sous la dalle est jugulé par la
maîtresse de céans. Le cadavre tari, au lieu
d’être rejeté à distance, est appendu à la
muraille de soie, comme si l’Araignée voulait
faire un épouvantail de son logis. Mais ce n’est
certes pas là son but. Agir en ogre qui suspend
ses victimes aux fourches patibulaires de son
castel, n’est pas le moyen de rassurer les
passants dont on guette la capture.
D’autres motifs
aggravent le doute. Les coquillages appendus le
plus souvent sont vides, mais il s’en trouve aussi
d’occupés par le mollusque, intact et vivant. Que
peut faire la Clotho d’un Pupa cinerea,
d’un Pupa quadridens et autres
étroites spires où l’animal recule à des
profondeurs inaccessibles ? Incapable de
casser l’étui calcaire et d’atteindre le reclus
par l’embouchure, pourquoi l’Araignée
cueille-t-elle pareille trouvaille, dont les
chairs visqueuses ne sont probablement pas de son
goût ? Le soupçon vient que c’est ici simple
affaire de lest et d’équilibre stable. Pour
empêcher sa nappe, filée dans l’angle des murs, de
se déformer au moindre souffle d’air, la Tégénaire
domestique la charge de plâtras ; elle y
laisse s’amasser les menues ruines du mortier.
Serions-nous en présence d’une industrie du même
ordre ? Essayons l’expérimentation,
préférable à toutes les conjectures.
Élever la Clotho
n’est pas entreprise onéreuse, obligeant de
transporter chez soi la pesante dalle où
l’habitation est assise. Une manœuvre des plus
simples suffit. Avec la pointe d’un canif, je
détache de la pierre les amarres de suspension. Il
est rare que l’Araignée détale, tant elle est
casanière. Du reste, je mets à l’enlèvement de la
case toute la réserve possible. J’emporte ainsi
dans un cornet de papier le logis avec sa
propriétaire.
Tantôt des
rondelles de sapin, débris de vieilles boîtes à
fromage, tantôt des tablettes de carton remplacent
les pierres plates, trop lourdes à transporter et
trop encombrantes sur ma table. J’y dispose
isolément le hamac de soie, en fixant, un par un,
les prolongements anguleux avec des bandelettes de
papier gommé. Trois brefs piliers supportent la
préparation. Voilà, sous forme de petits dolmens,
suffisamment imités les abris sous roche. Pendant
tout ce travail, si l’on a soin d’éviter les chocs
et les secousses, l’Araignée ne sort de chez elle.
Enfin les appareils sont mis sous des cloches en
toile métallique que reçoivent des terrines
pleines de sable.
Le lendemain, on
peut avoir déjà réponse à la question. Si sur le
nombre des cabines appendues au plafond des
dolmens en sapin ou en carton, il s’en trouve
quelqu’une de délabrée, de déformée outre mesure
au moment de l’extraction, l’Araignée l’abandonne
pendant la nuit et va se domicilier ailleurs,
parfois sur le treillis même de la cloche.
La nouvelle
tente, ouvrage de quelques heures, atteint à peine
comme ampleur le diamètre d’une pièce de deux
francs. Construite d’ailleurs d’après les mêmes
principes que les vieux manoirs, elle se compose
de deux maigres nappes superposées, la supérieure
plane et formant ciel de lit, l’inférieure courbe
et façonnée en pochette. Le tissu en est d’extrême
ténuité ; un rien le déformerait aux
détriments de l’espace disponible, déjà si réduit
et tout juste suffisant à la recluse.
Eh bien, pour
maintenir tendue la gaze délicate, la stabiliser
et lui conserver la plus grande capacité, qu’a
fait l’Aranéide ? Précisément ce que lui
conseilleraient nos traités de statique ;
elle a lesté sa construction ; elle en a
abaissé, de son mieux, le centre de gravité. De la
convexité de la poche pendent, en effet, de longs
chapelets de grains de sable liés par des
cordelettes de soie. À ces stalactites sableuses,
dont l’ensemble forme une barbe touffue,
s’adjoignent quelques lourdes masses isolées au
bout d’un fil et descendant plus bas. Le tout est
un lest, un appareil d’équilibre et de tension.
L’édifice
actuel, construit à la hâte dans l’intervalle
d’une nuit, est la fragile ébauche de ce que
deviendra plus tard la demeure. Des assises
successives seront ajoutées, et la paroi deviendra
finalement épais molleton apte à conserver en
partie de lui-même la courbure et la capacité
requises. Alors sont abandonnées les stalactites
de sable, si utiles à la tension de la pochette
initiale, et l’Araignée se borne à plaquer sur sa
demeure tout objet un peu lourd, principalement
des cadavres d’insectes, parce que, sans
recherches, elle les a sous les pattes après
chaque réfection. Ce sont là des moellons et non
des trophées ; ils tiennent lieu des
matériaux qu’il faudrait cueillir à distance et
hisser là-haut. Ainsi s’obtient un blindage qui
fortifie la demeure et la stabilise. En outre, un
surcroît d’équilibre résulte souvent de menus
coquillages et autres objets longuement appendus.
Qu’adviendrait-il
si l’on dépouillait de son revêtement une vieille
case, depuis longtemps parachevée ? En ce
désastre, l’Araignée reviendrait-elle aux
stalactites de sable, moyen rapide de
stabilisation ? C’est bientôt reconnu. Dans
mes bourgades sous cloche, je fais choix d’une
cabine de belle dimension. J’en dénude
l’extérieur ; j’en enlève soigneusement tout
corps étranger. La soie y reparaît dans son
originale blancheur. La demeure est magnifique,
mais elle me semble trop flasque.
C’est aussi
l’avis de l’Araignée, qui se met à l’ouvrage la
nuit suivante pour remettre les choses, en bon
état. Et comment ? Encore avec des chapelets
de sable appendus. En quelques nuits, la sacoche
de soie se hérisse d’une épaisse et longue barbe
de stalactites, ouvrage singulier, excellent pour
maintenir le tissu dans une invariable courbure.
De même les câbles d’un pont suspendu sont
stabilisés par le poids du tablier.
Plus tard, à
mesure que l’Araignée s’alimente, les reliefs des
victuailles sont incrustés, le sable ébranlé tombe
petit à petit, et le logis reprend son aspect de
charnier. Nous voici revenus à la même
conclusion : la Clotho connaît sa
statique ; par des poids additionnels, elle
sait abaisser le centre de gravité et donner de la
sorte à sa demeure l’équilibre et la capacité
convenables.
Or, que
fait-elle en son logis, si mollement
capitonné ! Rien que je sache. L’estomac
satisfait, les pattes délicieusement étalées sur
le moelleux tapis, elle ne fait rien, ne songe à
rien ; elle écoute le bruit de la terre qui
tourne. Ce n’est pas le sommeil, encore moins la
veille ; c’est un état moyen où persiste seul
un vague sentiment de bien-être. Sur le point de
nous endormir dans un bon lit, nous avons quelques
moments de béatitude, prélude de l’extinction de
la pensée et de ses tracas, et ces moments ne sont
pas les moins doux. La Clotho semble en connaître
de pareils, et largement elle en jouit.
Si je fais
bâiller l’huis de la cabine, invariablement je
trouve l’Araignée immobile, comme dans une
interminable méditation. Il faut les agaceries
d’un brin de paille pour la tirer de son
recueillement. Il faut l’aiguillon de la faim pour
la faire sortir ; et comme elle est d’une
extrême sobriété, ses apparitions au dehors sont
fort rares. En trois ans d’observations assidues,
dans l’intimité de mon cabinet, il ne m’est pas
arrivé une seule fois de la voir explorer, de
jour, le domaine de la cloche. C’est de nuit, à
des heures très avancées, qu’elle s’aventure
dehors, en quête de victuailles. La suivre dans
son expédition, n’est guère praticable.
La patience m’a
valu de la trouver, vers les dix heures du soir,
prenant le frais sur le toit plat de sa maison. De
là, sans doute, elle épiait le passage du gibier.
Effrayée par la clarté de ma bougie, l’amie de
l’obscur est à l’instant rentrée chez elle, se
refusant à toute révélation de ses petits secrets.
Seulement, le lendemain, un cadavre de plus
pendait à la muraille de la case, preuve de la
chasse reprise avec succès après mon départ.
Timide à l’excès
et nocturne, la Clotho nous dérobe ses
mœurs ; elle nous livre ses œuvres, précieux
documents pour l’histoire, mais elle nous cache
ses actes, en particulier la ponte, que je
rapporte par approximation au mois d’octobre. Le
dépôt des œufs est fractionné en cinq ou six
pochettes aplaties, de forme lenticulaire dont
l’ensemble occupe la majeure part du logis
maternel. Ces capsules ont chacune leur paroi
propre en superbe satin blanc, mais elles sont
tellement soudées d’une part entre elles, d’autre
part avec le plancher de la demeure, qu’il est
impossible de les séparer sans déchirures et de
les obtenir isolées. L’ensemble des œufs atteint
environ la centaine.
Sur le monceau
des pochettes se tient la mère, avec la dévotion
d’une poule sur sa couvée. La maternité ne l’a pas
flétrie. Quoique amoindrie en volume, elle a
toujours excellent aspect de santé ; son
ventre replet et, sa peau bien tendue affirment
tout d’abord que son rôle n’est pas fini.
L’éclosion est
précoce. Novembre n’est pas arrivé que les
pochettes contiennent des jeunes tout petits,
costumés de sombre avec cinq points jaunes,
exactement comme les adultes. Les nouveau-nés ne
quittent pas leurs alcôves respectives. Serrés
l’un contre l’autre, ils y passent toute la
mauvaise saison, tandis que la mère, accroupie sur
l’amas des loges, veille à la sécurité générale,
sans connaître sa famille autrement que par les
douces trépidations perçues à travers les cloisons
des chambrettes. Ce que nous a montré l’Araignée
labyrinthe, en permanence pendant deux mois dans
son corps de garde, pour y défendre au besoin sa
nitée, qu’elle ne verra jamais, la Clotho le fait
pendant près de huit mois, méritant ainsi de voir
un peu sa famille trottiner autour d’elle dans la
grande cabine et d’assister à l’exode final, le
grand voyage au bout d’un fil.
Quand arrivent
les chaleurs de juin, les jeunes, aidés
probablement par la mère, percent les parois de
leurs loges, sortent de la tente maternelle, dont
ils connaissent très bien, la secrète issue,
prennent quelques heures l’air sur le seuil, puis
s’envolent, emportés à distance par un aérostat
funiculaire, premier travail de leur tréfilerie.
La vieille
Clotho reste, insoucieuse de cette émigration qui
la laisse seule. Loin d’être fanée, elle semble
rajeunie. Sa fraîche coloration, son vigoureux
aspect font soupçonner une longévité capable d’une
seconde famille. Sur ce sujet, je n’ai qu’un
document, assez probant d’ailleurs. Les rares
mères dont ma patience ne s’est pas lassée de
surveiller les actes, malgré les minuties de
l’éducation et la lenteur du résultat, ont quitté
leurs demeures après le départ des jeunes, et sont
allées en tisser d’autres, chacune la sienne, sur
le treillis de la cloche.
C’étaient des
ébauches sommaires, ouvrages d’une nuit. Deux
tentures superposées, celle d’en haut plane, celle
d’en bas concave et lestée de stalactites en
grains de sable, constituaient la nouvelle
habitation, qui, épaissie par des assises de jour
en jour multipliées, serait devenue semblable à
l’ancienne. Pourquoi l’Araignée abandonne-t-elle
son vieux manoir, non délabré, de bien s’en faut,
et d’excellent usage encore, d’après les
apparences ? Si je ne me fais illusion, je
crois en entrevoir le motif.
La cabine
d’autrefois, si bien capitonnée, a de graves
désavantages ; elle est encombrée par les
ruines des chambrettes des fils. Extirper ces
ruines, que mes pinces n’arrachent pas sans
difficulté, tant elles font corps avec le reste du
logis, serait pour la Clotho besogne exténuante,
peut-être au-dessus de ses forces. C’est ici
résistance de nœuds gordiens, que ne peut
dissoudre la filandière même qui les a noués.
L’encombrant monceau restera donc.
Si l’Araignée
devait être seule, peu lui importerait, après
tout, la réduction de l’espace ; il lui en
faut si peu, juste de quoi se mouvoir ! Et
puis, quand on a passé sept à huit mois en la
gênante présence de ces alcôves, pour quel motif
le brusque besoin de plus ample étendue ? Je
n’en vois qu’un ; il faut à l’Araignée
spacieux logis, non pour elle-même, satisfaite
d’un étroit réduit, mais pour une seconde famille.
Où placer les
pochettes des œufs, si les ruines de la précédente
ponte font obstacle ? À la nouvelle nitée il
faut nouveau logis. Voilà pourquoi, sans doute, se
sentant les ovaires non taris, l’Araignée déménage
et va fonder un autre établissement. À cette
mutation de demeure se bornent les faits observés.
Je regrette que d’autres préoccupations et les
difficultés d’un long élevage ne m’aient pas
permis de continuer et d’établir à fond, comme je
l’ai fait pour la Lycose, les pontes multiples et
la longévité de la Clotho.
Avant de quitter
cette Aranéide, revenons rapidement sur un
problème déjà proposé par les fils de la Lycose,
lorsque, portés pendant sept mois sur le dos de la
mère, ils se maintiennent agiles gymnastes sans
prendre aucune nourriture. À la suite d’une chute,
cas fréquent, escalader une patte de leur monture
et se remettre prestement en selle est pour eux
exercice familier. Ils dépensent de l’énergie sans
se restaurer matériellement.
Les fils de la
Clotho, de l’Araignée labyrinthe et de tant
d’autres nous soumettent la même énigme ; ils
se meuvent et ne mangent pas. À tout époque du
jeune âge, même au cœur de l’hiver, par les âpres
journées de janvier, je déchire les pochettes de
l’une, le tabernacle de l’autre ; je
m’attends à trouver la marmaille dans une profonde
inertie, engourdie par le froid et le défaut de
nourriture. Eh bien, ce n’est pas cela du tout.
Aussitôt leurs loges effractionnées, les reclus à
la hâte sortent, fuient de tous côtés, aussi
agiles qu’aux meilleurs moments de leur vie
émancipée. C’est merveille de les voir ainsi
trottiner. La nichée de perdreaux surprise par un
chien n’est pas plus prompte à se disperser.
Les poussins,
encore mignonnes boules de duvet jaune, accourent
à l’invitation de la mère, se hâtent vers
l’assiette garnie de menus grains de riz.
L’habitude nous a rendus indifférents aux
spectacles de ces gracieuses machinettes animales
d’un fonctionnement si prompt et si précis ;
nous n’y accordons pas attention, tant cela nous
paraît simple. La science scrute et voit autrement
les choses. Elle se dit : rien ne se fait
avec rien ; le Poussin s’alimente, il
consomme, ou pour mieux dire il consume, et de
l’aliment fait chaleur qui se convertit en
énergie.
Si l’on nous
parlait d’un poussin qui, sept à huit mois
d’affilée, se maintiendrait apte à courir,
toujours dispos, toujours de preste allure, sans
se restaurer de la moindre becquée depuis la
sortie de l’œuf, nous n’aurions pas de termes
suffisants pour exprimer notre incrédulité. Or, ce
paradoxe de l’activité sans le soutien du manger,
la Clotho et les autres le réalisent.
Je crois avoir
démontré que les jeunes Lycoses, tant qu’elles
restent avec leur mère, ne prennent pas de
nourriture. À la rigueur, des doutes seraient
admissibles, l’observation restant muette sur ce
qui peut se passer tôt ou tard dans les mystères
du terrier. Là, peut-être, la mère repue
dégorge-t-elle à sa famille quelques miettes du
contenu de son jabot. À tel soupçon, la Clotho se
charge de répondre.
Comme la Lycose,
elle habite avec sa famille, mais elle en est
séparée par les cloisons des cellules où sont
hermétiquement enclos les petits. En cet état,
nulle possibilité de transmission d’aliments
solides. Si l’on songeait à des humeurs nutritives
qui, expectorées par la mère, s’infiltreraient à
travers les cloisons où les reclus viendraient
boire, l’Araignée labyrinthe nous dissuaderait de
cette idée. Quelques semaines après l’éclosion des
jeunes, elle périt, et les petits, toujours
renfermés dans leur chambre de satin pendant la
moitié de l’année, n’en sont pas moins agiles.
Se
sustenteraient-ils des soieries
enveloppantes ? Mangeraient-ils leur
maison ? L’hypothèse n’est pas absurde, car
nous avons vu les Épeires, avant d’entreprendre
une nouvelle toile, déglutir les ruines de
l’ancienne, l’explication n’est pas admissible,
nous affirme la Lycose, dont la famille est
dépourvue de tout rideau soyeux. Bref, il est
certain que les jeunes, tant des unes que des
autres, ne prennent absolument aucune nourriture.
Enfin on se
demande s’ils n’auraient pas en eux-mêmes des
réserves venues de l’œuf, matières grasses ou
autres dont la combustion graduelle se traduirait
en travail mécanique. Si la dépense d’énergie
était de faible durée, de quelques heures, de
quelques jours, volontiers on s’arrêterait à cette
idée d’un viatique moteur, attribut de toute
créature venant au monde. Le poussin le possède à
un haut degré ; il se tient stable sur ses
pattes, il se meut quelque temps avec le secours
seul de l’aliment que lui a fourni l’œuf ;
mais bientôt, si la pâtée manque à l’estomac, le
foyer énergétique s’éteint, l’oiseau périt. Que
serait-ce s’il lui fallait, des sept et des huit
mois sans discontinuer, se tenir debout, se
trémousser, fuir devant un danger ? Où
logerait-il les économies nécessaires à telle
somme de travail ?
La petite
Araignée, à son tour, corpuscule de rien comme
volume, où pourrait-elle emmagasiner assez de
combustible pour suffire à la mobilité pendant une
si longue période ? L’imagination recule,
effarée devant un atome riche de graisses motrices
inépuisables.
Force nous est
alors de recourir à l’immatériel, en particulier
aux radiations calorifiques venues de l’extérieur
et converties par l’organisme en mouvement. C’est
la nutrition énergétique ramenée à son expression
la plus simple : la chaleur motrice, au lieu
d’être dégagée des aliments, est utilisée
directement, telle que la rayonne le soleil, foyer
de toute vie. La matière brute a des secrets
déconcertants, témoin le radium ; la matière
vivante a les siens, plus merveilleux encore. Rien
ne dit que du soupçon suscité par l’Araignée, la
science ne fasse un jour vérité démontrée et
théorème fondamental de la physiologie."