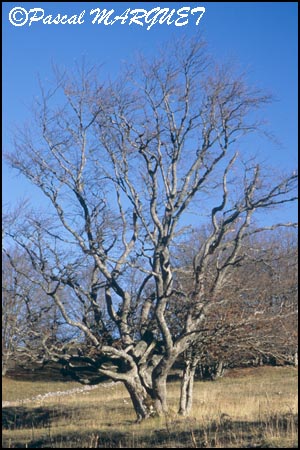Un
petit texte :
" Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires, mais on
le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était
insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait
pas une cabane mais une vraie maison en pierre où l'on voyait
très bien comment son travail personnel avait rapiécé
la ruine qu'il avait trouvé là à son arrivée.
Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait
faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages.
Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée,
son parquet balayé, son fusil graissé; sa soupe bouillait
sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé
de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que
ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux
qui rend les reprises invisibles.
Il me fit partager sa soupe et, comme après je lui offrais ma
blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux
comme lui, était bienveillant sans bassesse.
Il avait été entendu tout de suite que je passerais la
nuit là; le village le plus proche était encore à
plus d'une journée et demie de marche. Et, au surplus, je connaissais
parfaitement le caractère des rares villages de cette région.
Il y en a quatre ou cinq dispersés loin les uns des autres sur
les flans de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs à
la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités
par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits
où l'on vit mal. Les familles serrées les unes contre
les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien
l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme
en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure, dans
le désir continu de s'échapper de cet endroit.
Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leurs camions,
puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette
perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des
rancoeurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du
charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui
se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux
et pour la mêlée générale des vices et des
vertus, sans repos. Par là-dessus, le vent également sans
repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicides
et de nombreux cas de folies, presque toujours meurtrières.
Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa
sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un
après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les
bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposai pour l'aider. Il
me dit que c'était son affaire. En effet : voyant le soin qu'il
mettait à ce travail, je n'insistai pas. Ce fut toute notre conversation.
Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros,
il les compta par paquets de dix. Ce faisant, il éliminait encore
les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement
fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il
eut ainsi devant lui cent glands parfaits, il s'arrêta et nous
allâmes nous coucher.
La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai
le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le
trouva tout naturel, ou, plus exactement, il me donna l'impression que
rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument
obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir
plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture.
Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où
il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés.
Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de
fer grosse comme le pouce et longue d'environ un mètre cinquante.
Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route
parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes
était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à
la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais.
J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion
mais pas du tout : c'était sa route et il m'invita à l'accompagner
si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à deux
cents mètres de là, sur la hauteur.
Arrivé à l'endroit où il désirait aller,
il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait
ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le
trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui
appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle
était ? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une
terre communale, ou peut-être, était-elle propriété
de gens qui ne s'en souciaient pas ? Lui ne se souciait pas de connaître
les propriétaires. Il planta ainsi cent glands avec un soin extrême.
Après le repas de midi, il recommença à trier sa
semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il
y répondit. Depuis trois ans il plantait des arbres dans cette
solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille,
vingt mille était sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore
en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il
y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence.
Restaient dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit
où il n'y avait rien auparavant..."
Jean
GIONO - L'Homme qui plantait des arbres